Archives : les sorties en Salle et en DVD / Blu Ray
Films et DVD Blu-Ray - novembre 2016
Billets de Vincent Chenille

Tu ne tueras point
Réalisateur: Mel Gibson:
Où l’on apprend, dans ce film de guerre, à travers le soldat Desmond Doss, que les adventistes ne mangent pas de viande rouge. Tout comme ils n’utilisent pas d’armes pour tuer. Le spectateur ne manque pas d’associer ces deux interdits, où l’on devine que le goût du sang est associé à la consommation de viande rouge.

La grande course au fromage
Réalisateur : Rasmus A. Sivertsen
Il s’agit d’un dessin animé norvégien qui raconte une compétition entre deux villages montagneux, Pitchcliff et Pitchtown, consistant à transporter un fromage par monts et par vaux. L’origine de la compétition est prétendument placée au XIIème siècle, avec l’arrivée du roi dans la région. Les deux villages auraient voulu l’honorer.
Il n’est pas question de différences de goût entre les deux fromages, bien qu’ils ne soient pas fabriqués au même endroit ni de la même façon. Pitchtown est la cité fromagère depuis plusieurs générations, puisque s’y trouve une laiterie, un bâtiment de briques dont on ne voit pas l’intérieur. A Pitcliff, pas de laiterie ni de fromagerie, mais un inventeur qui a mis au point un procédé, une machine, qui permet de fabriquer un fromage à partir de lait caillé de n’importe quel animal. Ce sont surtout des chèvres que l’on voit dans la région, mais on peut tout aussi bien utiliser la vache, la brebis ou le bison. Cette invention n’a pas été reconnue par le directeur de la laiterie en son temps, mais c’est pourtant elle qui permettra à Pitchcliff de l’emporter.
Ce n’est pas une question de modernité. La laiterie aussi est mécanisée, mais il s’agit davantage, par cette diversité d’origine du lait, de choix raciaux et sociaux. Dans ces deux villages tous les habitants ne sont pas des humains. Il y a aussi un hérisson et un oiseau à Pitchcliff et un singe, à Pitchtown. La diversité est de mise dans les deux villages mais les « animaux » ne sont pas sur un plan d’égalité, selon que l’on se trouve à Pitchtown ou Pitchcliff. A Pitchtown, les animaux sont là pour exécuter les tâches ingrates, alors qu’à Pitchcliff ils sont placés sous un régime, si ce n’est égalitaire, du moins paternaliste, bienveillant. Ce sont donc deux régimes socio-politiques qui sont illustrés par ces deux villages et ces contenus en termes de fromages. Cette mise sur un même plan d’hommes et d’animaux aboutit logiquement à un choix diététique particulier.
Comme dans beaucoup de films contemporains, le choix du fromage est aussi affaire de diététique. Et il est à remarquer que le fromage absent, comme vedette alimentaire au cinéma depuis des décennies se rattrape ces dernières années, puisqu’il y a un peu moins de deux ans sortait le film américain The boxtrolls. De fait, dans La grande course au fromage, d’autres aliments sont présentés, de la nourriture de montagnard : saucisse et poisson de rivière. Le poisson est entouré de mouches, il n’est guère appétissant. Quant à la saucisse, elle est ridiculisée dans une publicité diffusée par une télévision locale. Elle est taillée en pointe aux extrémités pour faciliter sa cuisson au barbecue. Seul le fromage s’en sort, et il est le seul consommé réellement par les personnages (avec du pain et du réglisse au petit déjeuner) : un repas végétarien à défaut d’être végétalien.
Mettre sur un même plan hommes et animaux est une bonne promotion pour le statut des animaux. Toutefois les associer à des statuts sociaux inférieurs, minoritaires, c’est faciliter l’idée comme quoi ces catégories sociales seraient des sous-hommes ; confusion qui n’existait pas, par exemple, dans le dessin animé Comme des bêtes.

DVD - Silent Running
Réalisateur: Douglas Trumbull
Ressortie d’un classique du space opera
Le personnage central est un cultivateur dans l’espace, qui fait pousser fruits, légumes et autres végétaux. Il voudrait replanter des arbres sur la terre. Car, dans le futur décrit, le synthétique a remplacé le naturel sur notre planète. Ce film avait été remarqué à l’époque pour ses effets spéciaux. Si la réalisation demeure de qualité, les images de l’espace qu’il offre nous sont devenues davantage banales.
Quant au fond il est très marqué par l’essor du mouvement écologiste du début des années 70, avec une hantise du remplacement du naturel par le chimique. Echaudé par l’apparition des E312 et E314 sur les notices de composants de nos produits alimentaires, le film stigmatise le synthétique, qui a alors supplanté le naturel, en montrant des aliments, sphériques verts, cubiques blancs, mais surtout en critiquant l’absence de goût de ces produits préfabriqués. Un défaut que la chimie a aujourd’hui pallié avec les arômes. De nos jours, naturel et synthétique cohabitent dans l’agroalimentaire, tant qu’ils ne sont pas dangereux pour la santé. Toutefois, le film conserve une actualité et une pertinence avec la croissance de la consommation bio.
DVD et Blu-ray septembre 2016
Billet de Vincent Chenille

Ressortie en vidéo de Voici le temps des assassins de Julien Duvivier, sorti en 1953. C’est un incontournable pour qui s’intéresse à la gastronomie et aux cuisiniers représentés au cinéma. Le film est pionnier et constitue un tournant dans la représentation des cuisiniers. Il est pionnier, car si la cuisine n’est pas le sujet principal du film (il s’agit de l’histoire d’un homme mûr séduit par une jeune femme, qui est la fille de son ex-épouse) le nombre de scènes dans « Le rendez-vous des innocents », le restaurant tenu par M. Chatelin, dans le quartier des Halles, est très important. Il y a beaucoup plus de scènes de cuisine et de salle que dans les films précédents qui en montraient. Il faudra attendre plus de dix ans pour avoir régulièrement des films avec des personnages de cuisiniers disposant d’autant de scènes, tels que Le grand restaurant ou La cuisine au beurre. Il est important aussi dans la représentation qu’il donne des cuisiniers, parce qu’il en donne une image positive, ce qui n’était pas vraiment le cas auparavant (notamment, il utilise pour valoriser le cuisinier, une bonne critique gastronomique dans un journal).

Ressortie également de Marty de Delbert Mann, sorti en 1955. L’histoire est celle d’un italo-américain de 34 ans qui n’arrive pas à trouver d’épouse, parce qu’il est gros et pas beau. Il supporte, de plus, la pression familiale qui le pousse à trouver une compagne. Il se trouve que Marty est aussi boucher. Ce n’est pas un choix personnel. A la fin de la guerre, il était obligé de nourrir sa famille, un boucher a proposé de le prendre. Mais il ne voulait pas être boucher, car c’est un métier déconsidéré, un handicap de plus dans son rapport aux autres. Marty nous éveille au fait que les gros pas beaux, et aussi les bouchers, peuvent également être intelligents et sensibles. Les scènes de boutique sont peu nombreuses, mais le film grouille d’informations économiques. Car Marty envisage de racheter le fonds de son patron. Un fonds de boucherie à New York coûtait alors 5 000$, alors que le prix de la bavette était de 1,24$ et que quatre côtes de porc revenaient à 1,54$...
Comme des bêtes

Comme des bêtes
Réalisateurs: Chris Renaud et Yarrow Cheyney
Billet de Vincent Chenille
L’action se déroule à New York de nos jours, mais les êtres humains brillent par leur (presque) absence. Ce sont les animaux qui sont les protagonistes, aussi bien les domestiques que ceux d’élevage ou les sauvages. On y trouve un bulldog qui possède des biscuits et qui aime le beurre de cacahuètes. Mis à part cela, ce sont des mangeurs de viande. Ils aiment cela, car leur repas est souvent le fruit d’un larcin. C’est la chatte qui dévore dans le frigidaire le poulet de son maître, ce sont les deux chiens vedette qui connaissent un moment paradisiaque dans une usine de viande hachée et de saucisses. Ils mangent à n'en plus finir. Est-ce à dire que les animaux se mangent entre eux ? Les animaux sauvages sont tentés. Cachés dans les égouts, ils sont prêts à sacrifier les deux chiens à la vipère géante. Cela n’arrivera pas, pas plus que la chienne ne sera dévorée par l’aigle. Les deux finiront par s’entendre pour partir à la recherche du chien, dont elle est amoureuse. Le repas se limite-t-il aux animaux d’élevage (poulet, viande de bœuf ou de porc) ? Pas tout à fait, car parmi les animaux sauvages se trouvent des animaux d’élevage, qui ont été victimes d’humains (des animaux abandonnés en quelque sorte). On trouve donc un cochon, et à la tête de la bande, un lapin : deux animaux un peu frontaliers, car ils connaissent leur équivalent sauvage, et deux animaux qui ,même d’élevage, sont de hauts représentants d’interdits alimentaires. Dans ce monde animalier, ce sont certains animaux domestiques qui sont donc autorisés à la consommation. Nous sommes proches d’une alimentation humaine classique. La métaphore humaine s’attache jusque dans la distinction animal domestique, d’appartement, et animal sauvage, vivant dans l’égout. Distinction de classe, riches et laissés pour compte, le film invite à l’union et à ne pas s’entretuer ni se manger. Le lapin et le cochon sont là pour associer animaux sauvages et animaux domestiques sous une même humanité. Comme avec La tortue rouge ou le BGG, c’est l’anthropophagie qui est rejetée (à la différence près que dans Comme des bêtes, elle passe par la consommation de viande).
La tortue rouge

La tortue rouge
Réalisateur: Michael Dudok de Wit
Billet de Vincent Chenille
Généralement, dans les films de naufrage, les aliments sont très présents et facilement identifiables.
C’est un peu moins le cas avec La tortue rouge, qui est un film d’animation. Si le réalisateur a choisi un dessin réaliste proche de la photographie pour le décor, il a opté pour une ligne claire (à mi-chemin entre le réalisme et la caricature) pour les êtres et objets animés. Lors d’une scène, le héros nourrit un crabe, et il est difficile de dire avec quoi. Néanmoins ce récit de naufrage est intéressant du point de vue de la nourriture, comparé particulièrement aux Naufragés, sorti trois mois plus tôt, et qui dépeignait une île dénuée de nourriture. Ici, ce n’est pas le cas, même si les personnages ne se nourrissent pas dans la facilité (pas de supermarché à l’horizon). Et si Les naufragés incitaient à un régime végétarien, ce n’est pas le cas de La tortue rouge, dans lequel la famille naufragée mange aussi bien du poisson que des coquillages ou des noix de coco. Tout est-il permis dans la limite des ressources disponibles ? Pas tout à fait, et en cela les humains se distinguent des oiseaux, des araignées et surtout des crabes, qui pullulent. Ceux-ci mangent tout ce qui passe à leur portée : du poisson pour les oiseaux, des insectes pour l’araignée, et toutes les chairs possibles pour le crabe (poisson, tortue et tentative de manger de l’humain).
Les hommes, eux, ne mangent pas de tortue, ni de crabe ; le fils qui le porte à la bouche le recrache aussitôt. Juste naufragé, le père ne mange pas la tortue, pourtant à portée de sa main (le crabe s’en chargera). Il sera même ému par une tortue rouge inanimée, qu’il avait frappée, car elle détruisait son bateau. Bonne intuition, car cette tortue rouge se métamorphosera en femme et deviendra sa compagne. L’intérêt de La tortue rouge est qu’il associe culture scientifique et culture évangélique.
En effet, l’auteur suivant les théories évolutionnistes rappelle nos origines aquatiques et elles se focalisent sur ce poisson évolué, avec des bras à la place de nageoires, qu’est la tortue. D’autre part, les interdits alimentaires de La tortue rouge sont conformes à ceux du lévitique 11 1 48 avec les poissons à écailles et nageoires autorisés à la consommation et les tortues nommément interdites. Autrement dit, manger de la tortue, c’est manger de l’homme, et il est donc interdit de manger de l’homme et ce qui mange de l’homme.
TORIL

Toril est un film qui se trouve à l’intersection de Saint-Amour et de Dough. En effet, le film témoigne de la crise agricole, comme dans Saint-Amour, mais cette fois du côté des maraîchers. Jean-Jacques Lucas produit des abricots, des aubergines, des carottes, des melons. Mais ses abricots ont gelé et les ventes ne sont pas au rendez-vous pour ses autres fruits et légumes cultivés sous serre. Il n’a pas pu payer l’entrepôt qu’il loue pour stocker sa production depuis plus d’un an. Au début du film, il est menacé de saisie de son stock, de fermeture de l’entrepôt. Alors il prend son fusil et il se tire une balle.
Il en réchappera. Pendant sa convalescence, c’est Philippe, l’un de ses deux fils, qui viendra s’occuper de ses fruits et légumes. Et il aura à cœur de rembourser les dettes de son père et lui permettre de conserver son hangar. Pour cela, il utilisera un moyen peu orthodoxe, qui le rapproche du film Dough. Il se mettra en cheville avec un trafiquant de drogue et il vendra du cannabis sous couvert d’aubergines et de tomates. A la vente, les cours seront bien meilleurs. Cette idée, Philippe l’avait appliquée à lui-même, puisqu’il avait planté de la marijuana sur une partie de sa propre exploitation.
L’autre fils ne peut pas aider le père, il est dans la restauration. Le film ne s’attache pas trop à l’aspect culinaire du restaurant. Il utilise des courgettes cultivées par le père, et l’on sait qu’il fait de la nouvelle cuisine. Mais les informations sont surtout d’ordre économique. Il ne peut pas aider son père, parce que les affaires ne vont pas très fort. Il emploie des intérimaires et est souvent obligé de faire lui-même la plonge. Tout cela, parce que les clients « regardent leur porte-monnaie ». La copine de Philippe, qui travaille dans une pizzéria, s’en sort mieux.
Le père n’est pas le seul agriculteur à problème. Un reportage TV diffusé dans un bar nous montre un arboriculteur contraint d’arracher ses arbres fruitiers (qui avaient mis dix ans à donner des fruits) parce qu’il n’a plus les moyens d’acheter les produits nécessaires à leur entretien. A la fin du film, le père fera de même. Le film offre donc une image de la chaîne alimentaire contrainte à la débrouille, voire à la criminalité, pour survivre du fait du fonctionnement du marché. Il n’offre pas de solution pérenne. Comme dans Dough, elle ne peut passer par la criminalité. C’est la providence qui offre une fin pas trop catastrophique. Le père vend ses terres à son voisin et conserve le mas. Mais la providence peut-elle être toujours au rendez-vous ?
Elle permet en tout cas au père de se réconcilier avec ses fils. C’est pour ne pas les perdre qu’il vend ses terres, alors qu’il se plaignait de ne pas être aidé, que l’exploitation ne soit pas reprise par ses fils. Une fin affectueuse, heureuse, à défaut d’en avoir une économiquement viable. Le fossé père-fils, si présent dans les films traitant de cuisine et d’alimentation depuis un an, est comblé dans ce film mais ni l’un ni l’autre n’offrent de voie d’avenir.
Suicide Squad

Ma loute

L’histoire se déroule en Hauts de France, à la Belle Epoque, dans un coin de campagne près de la mer.
Les moules et les frites sont bien présentes. Les frites sont destinées aux grands bourgeois, qui ont une vaste demeure de villégiature. Les moules sont ramassées par les pêcheurs mais personne ne les mange. Pas même ceux qui les ont ramassées et qui vivent chichement du transport de voyageurs en barque. On se dit que les moules pourraient leur apporter des protéines. Mais ils vont les chercher ailleurs, avec les voyageurs bourgeois de passage venant de Lille et de Tourcoing qu’ils transportent.
Ceux-là, on ne les reverra plus. Ils finiront dans la marmite des pêcheurs.
Les bourgeois mangent aussi des protéines, mais pas de chair humaine. Ils consomment cependant la viande du sacrifice : l’agneau et le poulet. Tous pratiquent le sacrifice, mais selon leur moyen. On comprend aisément que les pêcheurs choisissent des personnes de passage et non des habitants du coin, qui pourraient plus facilement connaître les coupables. Cependant, au cours du film, les pêcheurs sont tentés de transformer en repas des bourgeois du coin qui se sont moqués d’eux. Ils y renonceront non par crainte de la police (le policier est un imbécile) mais par amour pour une des personnes capturées.
Si le film montre l’anthropophagie comme un moyen d’expression de la lutte des classes, il montre aussi qu’on ne peut manger ceux qu’on aime. Une vision qui tranche beaucoup de films d’anthropophagie récents, comme La chair de Marco Ferreri (1991) ou Trouble every day (2001) de Claire Denis. Ma Loute est le premier d’une suite de films d’anthropophagie dont la série a démarré cet été.
The neon demon

The neon demon
Réalisateur: Nicolas Winding Refn
Billet de Vincent Chenille
Le point de vue sur l’anthropophagie est identique à celui de Bruno Dumont dans le film de Nicolas Winding Refn (les deux films faisaient partie également de la compétition lors du dernier festival de Cannes).
De fait, deux cannibales y sont présentés, dans l’univers a priori très « civilisé » de la mode. Dans ce monde de beauté, la concurrence est rude et un mannequin n’hésite pas à dévorer celles qui, estime-t-elle, lui font de l’ombre ; histoire d’éliminer le concurrent, mais aussi d’avoir sa lumière.
Il s’agit d’un comportement cannibale classique : manger la personne admirée pour obtenir ses qualités. L’autre cannibale est aussi mannequin mais elle n’est pas une ambitieuse. Elle a choisi cette profession, car elle n’est pas douée pour autre chose. C’est donc quelqu’un de sincère, qui n’agit pas par calcul et qui n’est pas prête à tout. C’est sa propre survie dans ce monde de concurrence qui l’obligera à l’acte anthropophagique. Mais comme elle est sincère, elle ne digérera pas ce qu’elle a mangé.
Le bon gros géant

Le bon gros géant
Réalisateur: Steven Spielberg
Billet de Vincent Chenille
Bien qu’adapté d’un roman de Roald Dahl, paru dans les années quatre-vingts, Le bon gros géant colle à l’actualité cinématographique, et même cannoise, puisqu’il a été projeté au festival en même temps que Ma loute et The neon demon.
Comme dans ces deux autres films, il s’agit de cannibalisme. Même si, dans ce cas, ce sont des géants qui mangent des « hommes de terre » : ces géants ont une morphologie humaine et c’est bien le concept de cannibalisme qui est employé dans le film. Et comme dans Ma Loute et The neon demo, il y a une exception parmi ces cannibales : le bon gros géant qui donne son titre au film. Il mange des concombres (des schnockombres pour être précis) et trouve mal le cannibalisme.
A la différence des autres cannibales qui vont faire la chasse aux hommes à Londres le bon gros géant attrape les rêves avec un filet à papillons et va les souffler aux Londoniens endormis.
Les naufragés

Les films de survie sont propices aux représentations alimentaires cinématographiques, car les personnages y sont confrontés au problème de la faim, de la recherche d’aliments ; et c’est, bien sûr, le cas avec les récits de naufrage du type Seul au monde (2000) de Robert Zemeckis, Duel dans le pacifique (1968) de John Boorman ou L’île mystérieuse (1961) de Cy Enfield. La nature fournit alors, souvent dans la difficulté pour y accéder, de quoi se nourrir. Les naufragés répond à tous les codes de survie après un naufrage, ici dans les Caraïbes, sauf qu’ici, il n’y a rien du tout à manger ni à boire. La nature a beau être luxuriante, il n’y a pas de fruits sur les arbres ; quant au bord de mer, il semble vierge en poissons. De fait, la nature finira par livrer quelques poissons et l’île, une source d’eau claire. Mais la rigueur de la disette au début est destinée à mettre à l’épreuve le personnage : lui qui avait tout, n’a plus rien. Financier ayant détourné des milliards d’euros, il fuit la France pour éviter le fisc. Dans sa fuite précipitée, il conduit un avion dans la tempête, qui se crashe en mer. Il est accompagné d’un teinturier qui fait du tourisme, et qui l’aidera à nettoyer son âme en apprenant à vivre plus simplement, en harmonie avec l’environnement. Comme dans The big short, l’alimentation est une métaphore de la finance, à cette différence près que, dans le film américain, c’est la qualité des produits qui était en question, ici, il s’agit de quantité.
Dans cette nature sans fruits, les seuls aliments préservés sont ceux contenus dans un paquet de crackers, propriété du teinturier, qui rationne le paquet. Ce n’est pas du goût de Jean-Louis Brochard qui, malgré une entorse, ira voler un cracker pendant la nuit, tout en niant le lendemain l’avoir fait. Brochard apprendra à pêcher, le bernard-l’hermite d’abord, puis le poisson, et à ne plus disputer la viande. Car, sur cette île, se trouve un des derniers varans. L’île, en effet, n’est pas désertée, c’est un paradis pour touristes, avec un parc naturel, où se trouvent des espèces protégées, mais rien qui ne puisse nourrir le grand nombre de touristes. En dépit de l’abondance des buffets, le film pousse à la modération, car la nature n’est pas inépuisable. Brochard finira par ne plus contester les poules destinées au repas du varan et se contentera d’œufs volés dans des nids et de cueillette ; de même, pour les baies qu’il refusait au début, les suspectant d’être empoisonnée.
Sa punition, pendant tout ce parcours initiatique, sera d’ignorer qu’il se trouve non pas sur une île déserte, mais dans un parc naturel, alors que de l’autre côté de l’ile, les touristes font bombance à coups de cocktails et de crustacés. C’est le teinturier qui lui fera découvrir la vérité. Construisant un radeau, il sera déporté de l’autre côté de l’île et, là, il découvrira les journaux faisant la une avec les détournements de fonds de Brochard en même temps que l’abondance de l’hôtel. Lui qui s’était montré si partageur se jettera au départ sur la nourriture, rien que pour lui, puis il finira par apporter à boire et à manger au financier sans l’informer qu’il existe un hôtel de l’autre côté : Brochard pourrait y faire bombance, mais avant tout être arrêté. Cette situation amène à des anomalies alimentaires : Brochard s’étonne de l’existence d’une source d’eau pétillante sur l’île (le teinturier ne s’était pas aperçu qu’il avait ramené de l’eau gazeuse…).
Il s’agit bien dans ce film de partage et de modération pour des motifs environnementaux, pas pour des raisons communautaires. D’ailleurs, le film fait fi d’interdits religieux. Pour fuir, Brochard a acheté un passeport qui appartenait à un Arabe. Pour tous, il s’appelle donc Mustapha. Pour cette raison, le teinturier hésite à lui donner un cracker, car ils sont au bacon. Brochard croque le cracker en expliquant qu’il ne suit pas sa religion.
My skinny sister

My SKINNY SISTER
Réalisateur: Sanna Lenken
Billet de Vincent Chenille
Le film raconte l’histoire d’un problème alimentaire qui en masque un autre. Tout commence par une histoire de surpoids. Stella voudrait faire comme sa sœur Katja, qui est patineuse artistique. Elle s’engage dans la même école de patinage et commence à délaisser ses habitudes alimentaires pour suivre celles de sa sœur. Elle jette les chips à la poubelle et met de côté la purée à la cantine. Elle se contente d’un œuf dur et d’un verre de lait pour son repas. Si elle veut avoir le corps de sa sœur, c’est parce qu’elle lui envie sa robe à strass et son professeur de patinage, dont elle est tombée amoureuse.
Finalement, Stella délaissera son régime minceur, parce qu’elle s’apercevra que le professeur, qui est bien plus âgé, ne l’aime pas, et parce qu’elle découvrira que sa sœur est atteinte d’anorexie. Katja se prétend végétarienne pour éviter un repas d’anniversaire au restaurant. C’est un prétexte, car lors d’un repas familial, elle rejette une salade composée avançant qu’elle comporte du basilic. Katja se montre au fur et à mesure intolérante à tous les aliments. S’informant auprès d’une nutritionniste, Stella apprend que l’anorexie peut entraîner des crises cardiaques en cas d’efforts prolongés. Ce qui pourrait le cas de Katja, qui s’entraîne de façon acharnée au patinage. Du coup, les problèmes de rondeurs de Stella passent au second plan et deviennent des sujets humoristiques, dès lors qu’il existe une menace de mort.
Katja est prise dans un cercle infernal. Elle s’impose un régime à cause du patinage. Mais la fédération sportive lui interdit la patinoire, tant qu’elle n’aura pas repris des forces. Mais la perspective d’une vie sans patinage ne l’incite pas à vivre et donc à manger. Stella finira par avouer le secret de sa sœur à ses parents. Il ne s’agit pas de délation, de l’opposition du gros envers le maigre. Stella aime sa sœur et ne veut pas la voir mourir. A la fin du film, elle sera la seule confidente de Katja. Autrement dit, entre problèmes alimentaires, on se comprend. Le film insiste sur l’amour et la tolérance, mais il se termine dans une impasse, avec, certes, Katja dans une institution pour anorexiques mais non décidée à s’alimenter.
My skinny sister ne répond pas à la question de pourquoi Katja s’impose ce régime, alors que ses professeurs de patinage le lui interdisent. Ce film montre Katja prête à braver les interdits, à faire de grands sauts sur la patinoire. Katja est à la recherche d’un corps céleste. Ce qui rapproche ce film suédois du film américain Hungry hearts, sorti l’an passé. Pas de glorification dans cette recherche : Katja fait de grands sauts, mais finit par tomber dans les pommes… Le film montre ainsi l’inéluctable de cette logique.
Saint-Amour

Saint-Amour
Réalisateurs: Benoït Delépine et Gustave de Kervern
Billet de Vincent Chenille
Le Saint-Amour est un vin du Beaujolais, bu par Jean et son fils Bruno, dans un petit restaurant, lors d’une route des vins. L’ont précédé le Pouilly fumé et le Pinot noir et suivront le vin des Corbières, le Saint-Emilion. C’est un voyage à travers les régions viticoles françaises qu’effectuent le père et le fils, une façon de découvrir la richesse du patrimoine français en matière de vin, et de terroir, avec les vins du Rhône, seconde surface viticole française et le Bordelais, régions où les terres cultivées sont le plus occupées par la vigne. Un voyage éducatif aussi en matière de goût : les compères apprennent à mesurer la qualité du cru par la longueur des arômes en bouche. Un voyage qui cependant avait commencé dans l’ivrognerie. Car cette route des vins avait débuté au Salon de l’Agriculture, où ils étaient en compétition pour leurs bovidés. Une route rétrécie dans l’espace et où les verres de vin se succédaient rapidement. Face à l’ivrognerie de son fils, Jean décide de l’éduquer en lui faisant découvrir la dégustation à travers une vraie route des vins.
Le Saint-Amour a beau être le titre du film, la promotion de la vigne française n’est pourtant pas le sujet alimentaire principal du film. Car les protagonistes ne sont pas des viticulteurs, même si Pelvoorde songe à convertir ses terres en vignobles pour avoir plus de reconnaissance. Ce sont des éleveurs de bovins confrontés à la crise du prix du lait et qui se sentent mal aimés. La route des vins est une route empruntée par le père pour tenter de convaincre le fils de se tourner vers l’élevage de viande, afin de pérenniser l’affaire. Pour le fils, c’est une route initiatique vers la reconnaissance, celle de son père et celle d’une femme. Car dans la famille, la maman est morte depuis peu. C’est le sexe que recherche avant tout Poelvoorde, ainsi que le chauffeur qui véhicule le père et le fils ; la jouissance certes, comme avec le vin, mais avant tout animale. C’est par la sexualité que passe le plaisir principalement, mais aussi la possibilité d’un avenir. Le film met en parallèle l’accouchement humain et la mise à bas d’une vache. Comme pour Pension complète ou A vif, le film se termine vers un avenir difficile, mais possible, ouvert sur le collectif. Sur le plan gastronomique cette ouverture associe le végétal, la vigne et la viande, le bœuf. Elle se traduit par un échange lors d’un repas dans un hôtel des Corbières. Au petit déjeuner, une femme ne s’est servie que des végétaux, alors que le père a pris une assiette complète de saucisses. Il peut se le permettre, car il n’a que du bon cholestérol. La dame craque dans son régime végétarien, empruntant une saucisse au père et lui donnant en échange un morceau de pastèque.
Le crime du sommelier

Le crime du sommelier
Réalisateur: Fernando Vicentini Orgnani
Billet de Vincent Chenille
Il s’agit de Giovanni, un employé de banque, qui, trois ans avant cette histoire de crime, ne buvait que de l’eau et des jus de fruit. Il a été initié au vin par « le professeur », qui lui a fait goûter du Mazemino et qui lui a révélé son don insoupçonné d’odorat.
Le professeur est accompagné de trois disciples : Marco, Matteo et Luca. Face à l’inspecteur qui l’interroge sur ses alibis, Giovanni se rend compte que les disciples de ce professeur sans nom ont le prénom d’évangélistes, et que lui-même a le prénom du quatrième évangéliste. Tout porterait à croire que le professeur en question, qui l’initie au vin, est le Christ. Il s’agit d’une fausse piste, car le professeur dit au sommelier qu’il lui fait penser à Don Giovanni, à Dom Juan. Dom Juan est bien sûr le séducteur, mais il est aussi celui qui défie Dieu. Au service du professeur, il y a aussi Marguerite, celle qui va entraîner la chute de Giovanni, en disparaissant dans la nature, alors qu’il est accusé du meurtre de sa femme. Marguerite nous ramène à Faust et au pacte avec le diable.
De fait, Giovanni conclut un pacte avec le professeur. Il ne court pas après la jeunesse comme Faust, mais après les bouteilles de vin les plus rares, celles qui valent des milliers d’euros (dont une signée par Toscanini). A ce tarif-là, même son salaire de directeur d’agence bancaire ne lui suffit plus, il touche des rétrocommissions de fonds cédés au professeur. Réussite dans sa carrière, séduction des femmes, argent facile, Giovanni a tout du démon. Mais vient le moment de payer l’addition avec le meurtre de sa femme dont il est accusé, et ses alibis qui se dérobent ou qui meurent. Sa damnation n’a rien d’épouvantable, pas de flammes infernales, il retrouve le professeur et les trois autres évangélistes dans la montagne (le diable chausse un chapeau identique à celui porté par Joseph Cotten dans L’ombre d’un doute d’Alfred Hitchcock en 1943 ou par Jules Berry dans Les visiteurs du soir, de Marcel Carné en 1942, deux incarnations du diable) d’où ils s’apprêtent à dominer le monde.
Il n’y a donc rien de tragique dans cette damnation au contraire, ni dans le fait d’apprécier et boire du vin. Le film sort le produit de l’opprobre religieuse, qui peut exister à son encontre, non en contestant les péchés qu’on peut lui associer, mais en donnant une image sympathique du diable, une image héritée de l’épicurisme antique. Reste que Giovanni obtient son heureuse damnation par la mort de sa femme. Là encore, rien de tragique, puisque c’est le diable qui fait le boulot à sa place. Cependant, il y a bien une occasion, où il aurait volontiers tué sa femme. Jalouse des dépenses qu’il effectue pour le vin, elle met ses bouteilles sous séquestre et commence à vivre luxueusement. Pour le torturer, elle lui annonce, en pleine partie de golf de Giovanni, qu’elle ouvre la bouteille quinquagénaire. Il fonce la retrouver, juste le temps de boire la dernière goutte qu’elle lui a laissée. Il insulte son épouse, furieux, prêt à la tuer, avant qu’un homme ne l’assomme d’un coup de poing.
Giovanni ne commet pas le crime, et son épouse n’est pas assassinée pour son geste envers le vin, mais parce que les manipulations financières de Giovanni commencent à apparaître et qu’il y a un risque de remonter jusqu’au professeur. Cependant il y a un sentiment de supériorité chez ce sommelier qui distingue les fruits rouges et les fleurs dans ses crus, par rapport à l’épouse qui boit une bouteille de rouge 1996 avec une pizza. Il y a l’idée qu’ils appartiennent à une élite et que leur valeur dépasse celle de cette épouse. Le réalisateur en fait-il un principe ? Non, car si le récit a tout du conte universel, il s’inscrit bien dans notre monde contemporain. Et à ce titre, le film s’inscrit dans une promotion des cépages italiens, particulièrement par rapport à leurs concurrents français. Dans sa quête de patrimoine, Giovanni commence à acheter des vins français. Mais les bouteilles qu’il consomme au présent sont des vins italiens, le Mazemino, mais aussi le Giovanni Ferrari 95. Le film débute par un concours, un test à l’aveugle. De réputés œnologues y figurent, dont une Française. Mais c’est Giovanni qui les bat tous en découvrant et en faisant la promotion pour le vin pétillant Giovanni Ferrari. « N’hésitez pas à en ouvrir une bouteille », clame-t-il. Le crime du sommelier s’inscrit dans la veine de la crise financière de 2007-2008 avec des films comme Le loup de Wall street, The big short, avec des portraits de financiers, de traders. Critique, le film se caractérise par cette utilisation du diable, qui exprime le fait que le sommelier ne contrôle pas tout ce qui lui arrive, le disculpant par la même occasion. Cette introduction a aussi pour conséquence de réintroduire le religieux concernant le vin dans un contexte contemporain.
Les délices de Tokyo

Les délices de Tokyo
Réalisateur: Naomi Kawase
Billet de Vincent Chenille
Des films récents sur la gastronomie, c’est du film américain Chefs de John Favreau, que se rapproche le plus ce Délices de Tokyo, par sa recherche de l’authenticité et de la liberté pour retrouver un peu de créativité. Dans Chefs, le cuisinier quittait son restaurant réputé de cuisine internationale pour partir cuisiner de façon itinérante dans un food truck à partir de produits locaux. Dans Les délices de Tokyo, la question du mélange culturel ne se pose pas : il s’agit bien de plats japonais. Cependant, il y a une recherche de l’authenticité à travers les ingrédients. Habituellement, ce marchand de dorayaki, pâtisserie japonaise constituée de pâte et de haricots confits, confectionnait lui-même la pâte de froment, mais commandait les haricots confits de façon industrielle. Une rencontre avec une Japonaise retraitée l’amènera à fabriquer lui-même les haricots confits, même si ce n’est pas facile et que cela prend du temps, tout simplement parce que le goût en est meilleur. L’indépendance, il la gagnera en refusant de suivre le projet de sa propriétaire qui veut faire de son échoppe de dorayaki artisanaux, une boutique plus moderne de sucré/salé où les dorayaki côtoient les okonomiyaki, en nourriture préfabriquée. Il partira donc vendre ses dorayaki artisanaux de façon itinérante, dans des squares.
Il n’y a pas de quoi se réjouir dans ces Délices de Tokyo. Certes, il y a la très belle préparation des haricots confits au milieu du film, et les clients qui s’en régalent, toujours plus nombreux chaque jour. Il y a aussi cet espoir d’authenticité et d’indépendance, mais il n’apparaît que dans le tout dernier plan. Ce n’est donc qu’une faible lueur. Entre temps madame Tokue, qui avait donné le secret des haricots confits à Sentaro, meurt et les clients ont disparu. Un crève-cœur pour le cuisinier, qui perd celle qui était devenue son point de référence, ainsi que l’espoir de payer sa dette à la société. Lui qui rêvait de tenir un bar a vu ses espoirs envolés lors d’une bagarre avec un client, qu’il a rendu handicapé. Sa dette envers la société, il l’a payée d’abord par de la prison, puis par cette gérance de la boutique de dorayaki, pour la propriétaire. Du côté de madame Tokue, ce n’est pas plus réjouissant. Elle décède, après avoir connu une joie immense. Elle rêvait depuis longtemps de travailler dans une boutique de dorayaki, de servir des clients. C’est le jeune homme qui lui a permis de réaliser ce rêve. En retour, elle lui a livré le secret des haricots confits. Mais aux deux tiers du film cet espoir disparaît. Car quelqu’un a livré le secret de madame Tokue. Comment, en effet, détenir le secret de fabrication des dorayaki depuis une trentaine d’années sans avoir jamais travaillé dans un commerce de dorayaki ? Depuis la fin de la guerre, madame Tokue a en effet vécu dans une léproserie. Elle n’a gardé de sa maladie que des doigts déformés, mais encore agiles. Depuis 1996, le gouvernement japonais a mis fin à la quarantaine des lépreux, alors qu’ils n’y avait plus de risque de contamination depuis fort longtemps. Malgré cette levée de quarantaine, c’est la crainte qui habite les habitants de ce quartier de Tokyo, qui ne veulent plus manger de ces dorayaki qu’ils trouvaient délicieux, parce qu’ils ont été fabriqués avec les mains d’une lépreuse guérie.
L’espoir qui demeure à la fin du film est créé par cet homme, malgré la société. Cet homme a fait confiance à cette vieille dame, parce qu’il a goûté les haricots et les a trouvé bons, et parce qu’il l’a conservé comme employée, alors que sa propriétaire lui avait demandé de la renvoyer, ayant appris sa résidence à la léproserie. C’est le bon goût et le refus de l’opinion qui, pour finir, créent cet espoir. Un espoir fragile puisqu’il a déjà tué madame Tokue.
Si le film parle des marges, il ne témoigne pas d’une velléité de la société japonaise de finalement les intégrer. Et la question des micro-organismes semble mettre plus en marge que celle des délits de droit commun. Le partage des microbes, à travers la nourriture, semble peu accepté. Entre Les délices de Tokyo et Notre petite sœur, deux films sortis à la suite, nous avons le portrait d’une société japonaise, à travers l’alimentation, qui, certes, ne s’inquiète pas de la mondialisation, mais qui se montre irresponsable et soumise aux préjugés. Pas de quoi se réjouir…
The lobster

The lobster
Réalisateur : Yorgos Lanthimos
Billet de Vincent Chenille
The lobster fait partie de ces films rares qui donnent une recette de cuisine en intégralité. Ici, il s’agit du lapin farci aux poivrons, avec de l’ail et de la menthe. Mais la particularité du film tient au moment où est donné cette recette. Généralement, elle est donnée en cuisine ou au moment du repas, comme dans Le parfum de la carotte ou bien en fin de film comme dans L’attaque de la moussaka géante. Dans The lobster, elle est donnée au moment où le chasseur vient de tuer les lapins, encore sanglants et non dépiautés ; au moment le plus tragique donc. La musique triste qui accompagne la scène porte plus le spectateur à compatir face aux victimes qu’à noter les ingrédients pour réaliser la recette.
Cette impression négative se trouve renforcée par le fait que les animaux peuvent être des humains métamorphosés. La règle établie dans la société décrite est que l’humanité n’existe que par le couple. Les individus qui perdent leur moitié ou se séparent de leur conjoint, s’ils ne trouvent pas un autre partenaire dans un délai de quarante jours, sont transformés en animaux. Ce qui explique le titre du film The lobster (Le homard), animal dans lequel le personnage principal accepterait d’être changé, au cas où il ne trouverait pas de conjointe. Dès lors, il y a un doute sur ce que mangent les célibataires, reclus en forêt. The lobster, d’une philosophie animiste, fait donc la promotion du végétarisme, pas tant en habituant le spectateur à ce type de régime, mais plutôt en décriant le régime carné. Cela étant, en ville, on voit souvent les pensionnaires d’un hôtel à table, mais on ne sait pas ce qu’il y a dans leur assiette. On sait qu’une pensionnaire distribue des petits gâteaux au petit déjeuner.
Le désir de changement de vie s’exprimera aussi avec un gâteau. L’héroïne, qui veut quitter la forêt où elle chasse pour aller à la ville, y mange un gâteau à la crème qu’elle trouve visiblement bon. L’humanité serait donc dans le gâteau.
Pension complète

Pension Complète
Réalisateur: Florent Siri
Billet de Vincent Chenille
Pension complète est le remake de La cuisine au beurre, réalisé par Gilles Grangier en 1963.
Les deux films opposent deux caractères et deux cuisiniers autour de la même femme. Dans La cuisine au beurre, c’était l’opposition du nord et du sud, de la sole normande contre l’omelette à l’huile. Dans Pension complète, c’est l’opposition de la cuisine élaborée avec saumon à l’émulsion citronnée face à la cuisine populaire, au hamburger. Dans les deux cas, il n’y a pas tromperie, puisque les deux hommes sont légitimement époux de la même femme ; l’un est putatif. Le premier mari, disparu depuis une dizaine d’années, est considéré comme mort. A son retour, officiellement, il est toujours le mari et le second est putatif. Nous sommes dans une comédie, à visée heureuse. Bien évidemment, les deux hommes doivent se réunir autour de la même femme et ne plus s’opposer. Dans La cuisine au beurre, l’homme du sud se met au service de la sole normande, et l’homme du nord surmonte son mépris, car, avant lui, c’était « de la conserve ». Dans Pension complète, c’est le cuisinier populaire qui aide le grand chef à obtenir sa première étoile au Michelin, en mettant un hamburger à la carte ; grand chef qui n’affiche plus son mépris pour l’ancien cuisinier qu’il qualifiait de « surgelé, cafard ».
Pension complète apparaît comme l’antithèse de L’aile ou la cuisse, lorsque la grande cuisine du guide Michelin s’opposait au fast-food de Jacques Borel et dont l’emblème était le hamburger. Le film prend en compte la mise à la carte récente de hamburgers par des chefs étoilés. Même si ce ne sont pas les mêmes hamburgers que chez MacDonald. En ce sens, Pension complète va dans le même sens que On aurait pu être amies et Discount, en introduisant de la cuisine populaire, de la cuisine conviviale et de plaisir avant tout, dans la grande cuisine. Avant ce mariage du hamburger et de l’émulsion aux truffes, les cuistots du chef trouvaient sa cuisine trop classique et voulaient l’orienter vers du sucré-salé et du sushi. Ce qu’il se refusait à faire. Pension complète préconise le mélange des origines en cuisine, mais demeure dans un modèle occidental. D’un côté, il y a le saumon, les légumes traditionnels et bios, comme les carottes, les panais, les asperges, du restaurant Epicure (nom un peu prétentieux), de l’autre, il y a le hamburger de l’ancien restaurant Melrose Place, très ancré donc dans la culture américaine. La rencontre entre les deux se fera autour des pâtes (elles nous viennent de Chine, mais ont avant tout une identité italienne, et le film se déroule d’ailleurs sur la Côte d’Azur). Cela ne signifie pas pour autant que l’immigré est mis au ban. Il n’y a pas de porc dans le film et l’ancien chef est d’origine gitane. Mais on demeure dans une identité occidentale.
La question de l’identité ethnique est donc bien présente dans le film, même si elle est relativement moins importante que l’identité sociale. Elle l’était paradoxalement plus dans La cuisine au beurre, puisque cette femme entre cet homme du nord et celui du sud était assimilable à la France, territoire constitué d’influences géographiques de tous les pôles. C’est un paradoxe, car la question de l’identité nationale et de l’intégration en 1964 n’était pas sensible comme elle peut l’être aujourd’hui. Mais, dans La cuisine au beurre, cette diversité ethnique n’est là que pour légitimer par analogie les évolutions sexuelles de l’époque. Le film montre une femme légalement polygame, par défaut de la loi. De facto, les relations intimes qu’elle peut avoir avec son ex, en même temps qu’avec son mari, ne sont pas illégales ni interdites. Le film sort en même temps qu’arrive en Europe la pilule contraceptive, qui va faciliter les relations sexuelles des femmes avec des hommes différents. Ainsi La cuisine au beurre donne-t-elle l’image d’une femme avec plusieurs hommes et qui n’est pas irresponsable.
La question sexuelle est aussi très présente dans le remake de La cuisine au beurre, et elle entraîne des répercussions alimentaires. Contrairement aux cuisiniers qui figurent sur grand écran depuis le mois de septembre, on ne peut pas parler, dans sa vocation, de déficience concernant les parents du chef, puisque sa mère, qui est encore vivante, tient un petit restaurant à quelques kilomètres du sien. En revanche, on ne parle pas du père, qui demeure invisible. C’est de ce côté-là qu’il y a déficience, puisque le chef souffre d’infertilité. Une infertilité qui est passée inaperçue, car il est tout à ses fourneaux. Mais son épouse veut un enfant. C’est l’ex-mari qui viendra pallier cette déficience. Et la liaison sexuelle qu’il a avec son ex-épouse correspond au moment où il introduit le hamburger, c’est-à-dire la viande dans la carte. La virilité de l’ex a aussi une incidence positive sur l’obtention de l’étoile. C’est en couchant avec la femme d’un critique du guide Michelin que celui-ci se décide à venir au restaurant Epicure. On peut douter qu’il s’agisse d’un critère réel de choix de restaurant pour les critiques du Michelin. Mais le procédé comique aide à renforcer l’idée qu’il faut du sexe dans les plats qui sont cuisinés. La dimension sexuelle ne se limite pas à un discours alimentaire. Le chef apprend son infertilité après la naissance de l’enfant. Son attitude ne sera pas celle du rejet, au contraire, il sera tout ouvert à l’enfant et à l’ex-mari, qui lui aura permis de garder son épouse et d’obtenir sa première étoile.
The big short : le casse du siècle

The big short : le casse du siècle
Réalisateur: Adam McKay
Billet de Vincent Chenille
Beaucoup d’images culinaires dans ce film qui raconte la crise des subprimes aux Etats-Unis en 2008.
Du côté du cabinet du trader Mark Baum, on est à la recherche d’authentique. Un voyage d’affaires à Las Vegas leur laisse présager un petit restaurant cubain vraiment cubain ; recherche d’authenticité accrue chez Ben Rickert, un ancien trader, qui ne consomme que les fruits et légumes qu’il produit. Cette recherche d’authenticité s’oppose au mélange de produits dont l’origine est inconnue : financièrement, c’est la définition du subprime. Un chef étoilé nous explique par le menu ce qu’est ce produit financier à l’aide d’un saumon pourri recyclé avec d’autres poissons dans un nouveau plat pour être accepté. Au cabinet de Mark Baum, on se méfie des subprimes, on mise même financièrement contre, préférant l’investissement productif. La méfiance est davantage accrue chez Ben Rickert, qui a quitté Wall Street, parce qu’il s’agit « d’un mauvais lieu ».
Le film est fondé sur une histoire réelle avec des personnages existants, qui ont de fait misé contre les subprimes. Est-ce que leur goût culinaire est bien celui du film ? Toujours est-il que cette recherche d’authenticité conforte la culture régionale et les produits de circuits courts servis dans les food trucks, tels qu’ils apparaissaient il y a un an dans Chef de John Favreau, et que la culture de l’authentique gastronomique n’est peut-être pas liée uniquement aux circuits du produit alimentaire.
DVD et Blu-ray janvier 2016

Ce mois-ci, il faut noter la sortie vidéo du Feu follet (1963) de Louis Malle.
L’alimentation y est très présente, dont un repas d’araignées de mer. Mais le personnage central du film, Alain Leroy, n’y goûte guère, car il sort d’une cure de désintoxication. Le feu follet est remarquable pour la scène dans le bar américain, où le barman, habitué à le voir, lui prépare un whisky sour. Il ignore que Leroy sort de désintoxication. La scène est remarquable, car le barman met naturellement du sucre dans le whisky, puisqu’il est sour. Or, au cinéma depuis les années 1910, le sucre connote la relation sexuelle. Et justement, Alain Leroy vient dans le bar américain pour téléphoner à une femme. Mais la relation ne se renouera pas et, quand il refuse le verre du barman, il dit non à la fois à l’alcool et au sucre. Si cette scène est particulièrement intéressante, c’est que le sucre est très présent dans la filmographie de Louis Malle.
Il était présent quatre ans plus tôt, par exemple, dans son adaptation de Zazie dans le métro. Il y a une explication sociologique à cela : Louis Malle descend d’une famille de sucriers.
Notre petite sœur
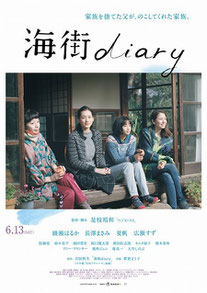
Notre petite sœur
Réalisateur : Hirokazu Kore-eda
Billet de Vincent Chenille
Dans ce film japonais, il est peu question de gastronomie (nous n’y sommes pas plongés comme dans Tampopo). On y trouve deux restaurants. L’un est un bistrot, où tous les clients semblent manger du maquereau mariné (sous forme de beignet ou non, voilà où se situe la nuance). On ne peut pas parler de gastronomie, même si tous les clients sont unanimes pour dire que c’est bon, tant l’aspect culinaire paraît limité. L’autre restaurant est un établissement thermal et l’on n’y voit pas l’ombre d’un aliment.
Cependant, ce film a été remarqué pour l’importance de la nourriture. Plusieurs personnes me l’ont signalé (qu’elles en soient remerciées). Il est vrai qu’il y a beaucoup de scènes où les personnages mangent ou font la cuisine en dehors même du restaurant. L’intérêt n’est pas tellement dans les plats, qui constituent un repas japonais moyen : nouilles, pâte de haricot, croquettes de riz, sauce de soja, et, un peu plus rare, des alevins. On remarquera qu’il s’agit presque exclusivement de végétaux. Notre petite sœur ne déroge pas aux règles des films d’autres nationalités, dès lors qu’il s’agit de femmes, il s’agit de repas végétariens. Or le film raconte l’histoire de quatre sœurs vivant ensemble. Il y a bien des allusions au bœuf sauté. Mais il s’agit d’une allusion en classe d’un personnage secondaire, dont on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une leçon apprise. La seconde sœur le cite également, parce qu’elle le voit affiché au menu d’un restaurant dehors. Elle fait ce simple commentaire : « N’en parlons pas ».
La nourriture est bonne, qu’elle soit domestique ou celle du restaurant, mais il y a peu de discours sur le goût, si ce n’est pour féliciter la sœur aînée, car ses condiments ne sont pas trop salés. Le réel intérêt alimentaire du film tient dans ses personnages : qui mange et qui fait la cuisine. Ce sont les quatre sœurs qui mangent. Il y a d’autres personnages qui mangent (petit ami, tante, mère), mais toujours en compagnie d’au moins une des sœurs. Et les scènes où ce sont uniquement les quatre sœurs qui mangent sont les plus nombreuses. Aucune explication n’est donnée au fait qu’on les voit manger autant de fois. Mais on sait que dix ans plus tôt le père a quitté le foyer pour aller avec une petite amie. Honteuse d’être ainsi répudiée, la mère a aussi quitté le foyer. Voilà pourquoi les quatre sœurs vivent ensemble. En mangeant, les enfants compensent les parents nourriciers absents. Même s’ils n’ont jamais eu faim.
Côté cuisinier, on est également dans la compensation, le transfert. C’est la fille aînée, celle qui a élevé ses jeunes sœurs, qui fait la cuisine. Quelquefois aidée par l’une de ses sœurs, elle l’a fait pour la famille, ainsi que pour son petit ami. C’est elle que l’on voit faire le plus souvent la cuisine, davantage même que la cuisinière du bistrot. La réconciliation avec la mère aura également une traduction alimentaire. La fille aînée, la plus remontée contre elle, lui offrira un pot de mirabelles de leur jardin (conservées dans de l’alcool) et datant du temps de la grand-mère. Puis elle réalisera le seul plat que lui a appris sa mère, à base de coques et de palourdes. La mère n’aimait pas cuisiner et elle réalisait des recettes qui ne demandaient pas de cuissons longues (donc pas de viandes).
Cette vocation culinaire est intéressante, non pas parce qu’elle nous éclaire sur la culture japonaise, mais parce qu’on retrouve la déficience des parents à l’origine de la vocation de tous les cuisiniers (amateurs ou professionnels) dans tous les films depuis septembre, quelle que soit leur origine nationale. Le jeune africain dans Lamb fait la cuisine à la manière de sa mère décédée et la commercialise car son père, parti à la ville, n’est pas là pour s’occuper de lui. Mais c’est le cas également d’Adam Jones, le chef américain dans A vif, qui a eu une enfance difficile, sans mère et avec un père absent. Mais c’est le cas aussi de Premiers crus, où le fils vient refonder la famille après le départ de la mère et de la déficience du père, qui veut quitter son terroir. Ce sont des traits qui n’étaient pas observables dans Le festin de Babette, Vatel ou même Les saveurs du palais. Il s’agit d’un phénomène nouveau et significatif de par son ampleur et parce qu’il touche de nombreux pays.
A Vif
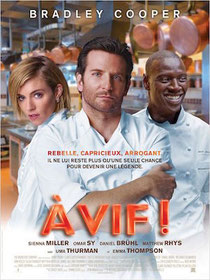
A Vif de
Réalisateur: John Wells
Billet de: Vincent Chenille
Retour aux Archives de janvier 2016
Retour aux Archives des Sorties Cinéma et DVD
>
Le film américain de John Wells traite davantage de cuisiniers que de cuisine. Néanmoins, elle n’est pas absente ni de l’image ni du discours, et le titre du film l’évoque en partie. Le cuisinier américain Adam Jones jette son dévolu sur un restaurant londonien pour y pratiquer la cuisine « à l’ancienne », c’est-à-dire avec des aliments cuisinés sur le feu, la seule garante selon lui de la saveur des aliments. Il se démarque de la cuisine moléculaire (il met en boîte son ami pour un steak réchauffé à la lampe). Il se démarque aussi de la cuisine mijotée sous plastique. Mais il se heurte avec son équipe à la rapidité de l’exécution et du service. Le plat exécuté doit être servi aussitôt (et les commandes arrivent toutes en même temps). Il conclut donc un compromis avec des plats cuisinés à vif, mais maintenus au bain-marie, sous plastique.
S’il officie dans un grand restaurant, il constitue son équipe aussi bien dans un bon restaurant italien que dans un kebab de quartier, quitte à s’opposer à ceux qui refusent de manger dans un fastfood, parce que c’est trop gras, trop salé. Il défend la cuisine de paysan, en faisant remarquer que le bourguignon a aussi le défaut d’être trop gras et trop salé. On y trouve donc de tout quant aux aliments, bœuf, porc, flétan, turbot, légumes. A une amie, il prépare de la mozzarella végétarienne, et à son mari, un plat de viande aux escargots, bien que ceux-ci soient considérés comme « ringards ».
La cuisine française fait partie de la culture d’Adam Jones, puisque c’est à Paris qu’il a été formé par Jean-Pierre et qu’il a aussi tenu son premier restaurant. La plupart des membres de son équipe sont des Américains et des Anglais formés par Jean-Pierre (il y a un Français), dont on apprend le décès au début du film. Si la cuisine française est donc bien représentée (ainsi que la langue), les cuisiniers français sont des fantômes. On apprécie qu’un film américain ne catalogue pas les personnages français comme des méchants, si ce n’est qu’aux trois quarts du film le cuisinier français épice délibérément trop les plats, qui sont renvoyés en cuisine par les clients : parmi eux des « critiques du guide Michelin ». Pourquoi le cuisinier français a-t-il fait cela ? Par vengeance. A Paris, il tenait un restaurant qu’Adam Jones avait réussi à faire fermer en y amenant des rats et en prévenant les services d’hygiène.
A vif ne met pas en cause la vengeance du cuisinier français, mais jette un doute sur la mauvaise réputation de la cuisine française (celle de la putréfaction) répandue par des Américains. Pourquoi Adam Jones avait-il agi ainsi ? Pour être considéré comme le meilleur, pour écarter la concurrence. Au début du film, lorsqu’il fait son come-back à Londres, Adam Jones continue à saper la concurrence en allant manger dans certains restaurants et en se plaignant de la nourriture. Une attitude qu’il paye donc en embauchant le cuisinier français, qui promet de l’aider à obtenir sa troisième étoile, tout en travaillant contre lui. A vif critique la compétition entre les cuisiniers, parce que c’est une perversion. Elle n’aboutit pas à donner aux clients la meilleure cuisine possible, puisqu’elle oblige un bon restaurant à fermer ses porte. Mais aussi parce qu’elle détruit les liens sociaux et les individus. Le titre A vif illustre bien la pression que met Adam Jones au moment du coup de feu sur ses cuisiniers : les assiettes qu’il balance de colère, parce que le plat n’est pas parfait, les cuisiniers qu’il saisit par le col. Déjà, à Paris, Adam Jones avait manifesté son autoritarisme. Son incapacité à obtenir ce qu’il souhaitait avait entraîné son autodestruction. Fiction ? Comment ne pas penser à Bernard Loiseau et à sa fin tragique à la suite d’une étoile retirée ? A vif, qui a tous les traits de la comédie culinaire avec le chef en voie de réussite sociale et la rencontre avec une probable compagne, est plutôt une peinture sociale et psychologique d’un homme et d’un métier subtilement présentés. Le film n’y fait pas allusion, pourtant dans la ligne de mire du film, il y a les émissions culinaires de téléréalité, où l’intérêt pour le spectateur, faute de pouvoir goûter les plats, est de savoir qui est le meilleur.
A vif est une comédie dramatique, donc avec des éléments de comédie et d’autres, de drame, mais pour finir, il ne se termine pas mal. Le lien social se recrée, la cuisine redevient un travail d’équipe avant que d’être la seule promotion d’un individu, Adam Jones se fait plus apaisé. L’esprit de compétition a disparu, mais pas celui de concurrence ni de perfection. Tombé une nouvelle fois au fond du trou après l’affaire du guide Michelin, Adam Jones est récupéré par son concurrent le plus direct, celui avec lequel il a échangé le plus d’insultes. Pourquoi tant de magnanimité : parce qu’Adam Jones est un bon cuisinier et que tous ses concurrents progressent grâce à lui. Il est même le meilleur, parce qu’il entraîne vers des territoires culinaires encore inconnus. Adam Jones a néanmoins un curseur gustatif dans sa quête et c’est la devise de Jean-Pierre, son mentor : « Dieu a créé les huîtres et les pommes et le but de la cuisine est d’essayer de faire aussi bien ».
Seul sur Mars

Seul sur Mars
Réalisateur : Ridley Scott
Billet de Vincent Chenille
Pour faire la promotion de ce space opera, il a été présenté comme étant dans la veine d’Interstellar. Si les deux films sont bien des œuvres dans l’espace quant au fond, tout les oppose. Autant Interstellar se montrait pessimiste sur l’humanité et sur l’avenir écologique de la terre, autant Seul sur Mars est très optimiste. A l’inverse des vols spatiaux d’Interstellar, réservés à une élite, alors que l’humanité sur terre est destinée à mourir, Seul sur Mars nous montre un vol habité qui n’hésite pas à aller chercher un astronaute sur Mars (laissé pour mort, alors qu’il est bien vivant) au péril des réserves en oxygène de la fusée. Concernant l’alimentation, tout les oppose également. Aux terres tombant en poussière pour cause de réchauffement de la terre d’Interstellar, Seul sur Mars montre qu’il est possible d’avoir de l’agriculture sur Mars (le film a été conçu en collaboration avec la Nasa). Il se trouve que le héros abandonné sur Mars, Mark Watney, est un botaniste. Il va cultiver des pommes de terre sur le sol rouge de Mars. Pour ce faire, il utilise ses excréments comme fertilisant, et pour l’eau, il en fabrique à partir de bouteilles d’oxygène en réaction à des bouteilles d’hydrogène. Après Mad Max, Seul sur Mars est le second film futuriste à montrer un avenir alimentaire possible.
Vice versa

Vice versa
Réalisateurs: Pete Docter et Ronnie del Carmen
Billet de Vincent Chenille:
Le nouveau dessin animé des studios Pixar traite des sentiments, des humeurs ; y sont figurées aussi bien la colère que la joie. Le dégoût également. Il s’agit d’un antonyme. La figure ne provoque pas le dégoût (les animateurs ont tout fait pour que le personnage ne soit pas laid) mais elle l’exprime. Et donc le personnage exprime le goût à rebours. Il ne se limite pas à l’aspect culinaire, même si celui-là est bien présent. Le dégoût s’exprime aussi quant au décor, à l’apparence. Il n’aborde pas la question de la sexualité, car le film est d’abord destiné aux enfants. Ce qui est mauvais, du point de vue alimentaire, dans le film, c’est ce qui rend malade. Et ce qui rend malade se perçoit à l’odeur. L’héroïne a horreur des brocolis. Elle est dans la norme de la consommation enfantine. Elle n’a pas de problème avec tous les végétaux, puisqu’elle mange avec appétit des céréales au petit déjeuner (surtout qu’elles sont sucrées). Elle a plutôt des problèmes avec les légumes. La viande n’est pas présente, mais sous-entendue. Lorsque l’héroïne déménage à San Francisco, elle décide d’aller manger une pizza avec sa mère. Et là, c’est le cauchemar, car il n’y a que des pizzas aux brocolis. L’héroïne se plaint de cette ville, où il n’y a qu’une seule variété de pizza. Rien de mortel cependant. Alors pourquoi parler de maladie associée aux brocolis ? Ce n’est pas expliqué. On peut donc penser que c’est lié à l’amertume, considérée de façon ancestrale comme la saveur du poison.
La bataille de la montagne du tigre

La bataille de la montagne du tigre
Réalisateur: Tsui Hark
Billet de Vincent Chenille
Il est particulièrement intéressant d’observer les nouveaux films du réalisateur du Festin chinois (1995) en matière de représentation alimentaire. Son nouvel opus s’inscrit finalement dans un courant international qui oppose les végétaux et la viande. L’action se situe en 1947, alors que la jeune armée populaire chinoise lutte contre les troupes du kuomintang. Mais dans cette région de la Chine, ce sont des bandes de brigands qui font la loi, et l’armée populaire lutte contre eux. En manœuvre, elle n’a que de… l’eau chaude à manger, car il n’y a rien à mettre dans la soupe. C’est un fait notable, car dans les films de guerre rares sont les cas où les soldats ont faim (à moins d’être assiégés). Ils mangent souvent mal, mais ils sont approvisionnés. Là-dessus arrive un de leurs espions avec des provisions. La soupe est enrichie. On ne dit pas avec quoi, mais c’est long, blanc, et ça se découpe en rondelles ; c’est donc plutôt un végétal. Du côté des méchants, c’est clairement de la viande. Il y en a deux en vadrouille qui ont fait rôtir du rat à la broche. Mais dans le repaire du grand méchant, les carcasses de viande sont beaucoup plus grandes que du rat…
DVD et Blu-ray octobre 2015

Le cercle rouge (1970) de Jean-Pierre Melville
Tous les films de Jean-Pierre Melville ressortent en blu-ray. Le cercle rouge est incontournable pour qui s’intéresse à l’alcool au cinéma, car on y trouve la plus incroyable scène de delirium tremens, avec mygale géante surgissant dans un appartement urbain.
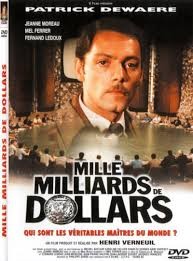
Mille milliards de dollars (1981) Henri Verneuil
Ce film parle du temps du repas, de son chamboulement. Venu faire un reportage à Bruxelles sur une multinationale(GTI, le journaliste Paul Kerjean arrive à quatre heures du matin pour un dîner. Car pour les cadres et dirigeants de cette multinationale, il est vingt et une heure. Tant et si bien que Kerjean ne sait pas s’il doit demander un whisky à une heure plutôt consacrée au café au lait. La mondialisation change les heures des repas, mais elle n’est pas la seule en question. L’ancien employeur de Paul Kerjean, qui dirige un journal régional, donne par téléphone la recette de la dinde farcie, alors que nous ne sommes pas en période de Noël. « Mon estomac ne fonctionne pas au calendrier, dinde de Noël, poisson le vendredi, poule au pot du dimanche », commente-t-il. Toutefois il existe une différence alimentaire entre ces deux repas : celui de l’artisan est parfaitement identifiable, la dinde, celui de la multinationale ne l’est pas. On sait juste que le repas est meilleur que l’ordinaire : « Vous avez peu le temps de voir vos femmes et vos enfants, hôtels, sandwichs. Alors aujourd’hui mangez, buvez, amusez-vous ».
Mad Max
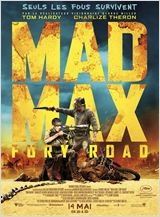
Ce mois-ci, deux films qui s’intéressent aux origines de la cuisine et de la gastronomie, et un qui s’intéresse à son futur. Les deux films sur l’origine de la cuisine l’associent à la naissance de l’humanité.
The fury road
Réalisateur: George Miller
avec Tom Hardy, Charlize Theron et Mel Gibson
Billet de Vincent Chenille
Avec Mad Max , l’action ne se situe pas dans le passé, mais dans le futur ; même s’il s’agit d’un futur qui ressemble à un retour en arrière tribal.
La question de l’avenir alimentaire y est présente. Elle l’était déjà dans Mad Max 2, mais elle l’est d’autant plus que les films de science-fiction aujourd’hui traitent fréquemment de cette question, que ce soit The road ou Interstellar.
La question de la raréfaction des ressources et le problème écologique sont au cœur de Mad Max, à l’instar des autres films de science-fiction.
Mais là où elle était une conséquence de la crise financière dans The road, ou de la surpopulation dans Interstellar, elle est due, dans the fury road, à un monopole sur les ressources fondamentales : l’eau, le lait, le pétrole (surnommé Cola), sont confisquées par l’immortel Joe. Ce personnage séquestre les femmes dans un harem, exploitant leur sexe et leur lait. Il emploie aussi des fanatiques auxquels il laisse entrevoir le paradis par leur sacrifice pour aller faire provision de Cola. Il tient le reste de la population à sa merci, en ouvrant de temps à autre les vannes de l’approvisionnement en eau. Insuffisamment pour que tout le monde puisse en profiter, alors que les réserves sont d’abondance. Cet immortel Joe ressemble évidemment à un chef terroriste du Moyen-Orient (même si nous somme dans le désert australien). La libération viendra de Max, mais aussi de Furiosa, une femme qui libère ses sœurs du harem et veut les conduire sur une terre exploitable pour l’agriculture.
Car les femmes sont les dernières gardiennes des semences végétales. La viande n’est pas absente, mais l’élevage est absent (l’herbe est rare). Bien entendu, c’est un homme qui mange de la viande, et il s’agit d’un lézard avalé cru par Max. Celui-ci et Furiosa réussiront à tuer Immortal Joe et l’eau coulera de nouveau pour tout le monde, avec l’espoir grâce aux semences d’une terre de nouveau fertile.
Plus violent que certains films précédents de la série Mad Max, the fury road est cependant plus optimiste. Depuis Mad Max 2, le monde est touché par la pénurie. Mais il n’y avait pas d’issue offerte. Avec la pénurie de pétrole, l’agriculture était impensable, aussi les solutions consistaient à manger les réserves de conserves, à consommer des bêtes sauvages (dans Mad Max 4, c’est un lézard, dans Mad Max 2, c’était un serpent), à avoir de petits élevages de basse-cour (poulets, cochons) et à pratiquer l’anthropophagie. Avec Mad Max 4, il y a une solution pour les ressources de base, l’agriculture réapparaît, mais c’est l’élevage et les conserves qui ont disparu. L’herbe va repousser, mais elle est d’abord destinée aux hommes. La solution dans le monde de Mad Max passe donc par un avenir écologique, où l’eau compte plus que le pétrole, et végétarien. Des solutions qui font écho aux questions alimentaires et de ressources d’aujourd’hui. Mais peut-on s’identifier au monde de Mad Max 4, où les ressources sont raréfiées pour servir des monopoles et où tout élevage a disparu ? Pas tout à fait.
Et Mad Max 2, avec ses pénuries de ressources naturelles, ressemble davantage à un futur possible.
Pourquoi j'ai pas mangé mon père

Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Réalisateur: Jamel Debbouze
Billet de Vincent Chenille
C’est l’histoire du chaînon manquant que nous raconte Jamel Debbouze dans son film d’animation.
Edouard est le fils aîné du roi des simiens (des singes), mais il est plus chétif que la normale (il est la manifestation d’une mutation).
Pour cette raison, il n’est pas intronisé, comme il devrait l’être. Mais il le deviendra en faisant découvrir à son peuple le feu, l’habitat moderne, l’amour.
Il découvre la cuisson un peu par hasard, un animal étant tombé sur le feu qu’il a préparé. L’odeur, bonne, attire du monde et suscite la fête. Cette innovation est mise en parallèle avec une rupture dans la tradition alimentaire. Edouard refuse de manger son père, qui vient de mourir. Il institue la première sépulture. La cuisine et l’inhumation, ainsi que la chasse, seraient donc nées d’une rupture avec l’anthropophagie.
Le film est adapté d’un roman de 1960 qui s’intitulait d’ailleurs Pourquoi j’ai mangé mon père. Il s’agit d’un raccourci préhistorique concernant l’anthropologie humaine, puisque la découverte du feu date d’il y a 790 000 ans, alors que la cuisson n’est apparue que 290 000 ans plus tard. Les sépultures sont, quant à elles, plus récentes, puisqu’elles ont entre 300 et 400 000 ans. L’enterrement a suivi chronologiquement la naissance de la cuisson, on ne peut donc pas faire naître la cuisine d’une rupture avec des pratiques anthropophagiques et de l’apparition des sépultures.
Sea fog

Les clandestins
Réalisateur: Sung Bo Shim
Billet de Vincent Chenille
Sea fog parle aussi à sa manière des origines de la cuisine, bien que l’action se situe en 1998, en Corée.
Car elle distingue la cuisine de l’alimentation et des pratiques archaïques liées à l’alimentation. Il s’agit d’un bateau de pêche avec son équipage.
Et le film nous montre l’ordinaire de l’alimentation de cet équipage avec le pademan, sans plus de commentaire. Mais il nous montre aussi des rituels anciens, religieux, sacrificiels. C’est le capitaine du bateau, (Kang Chul-joo), qui les pratique dans sa cabine, étalant cinq ou six plateaux différents.
Les aliments sont sacrifiés et consommés dans le cadre d’une prière destinée à apporter la prospérité : que la pêche soit fructueuse. C’est le profit de sa petite communauté maritime qui l’intéresse. Il n’hésitera pas à renoncer à une pêche abondante parce que l’un de ses marins s’est pris les pieds dans le filet et risque d’être broyé.
Mais il n’hésitera pas non plus à sacrifier aux requins tout un chargement d’immigrés chinois. Car pour compenser la perte de son revenu de pêche il a accepté de transporter des immigrés chinois souhaitant venir travailler en Corée. Ces travailleurs périront à la suite d’une fuite de gaz. Pour ne pas rester avec des morts sur les bras, le capitaine décidera donc de les découper de la même façon que les poissons pêchés et de les donner en pâture aux requins.
Le film se situe au moment de la crise financière asiatique de 1998. Les économies des « dragons » émergents dépendent pour se financer des capitaux étrangers. Ceux-ci se sont brutalement retirés en 1998, créant de lourds problèmes de trésorerie. Le film fait donc un parallèle entre les sacrifices religieux archaïques et ceux exigés par la mondialisation financière.
Mais il y a un troisième comportement alimentaire qui se distingue de la nourriture et de l’holocauste, c’est la gastronomie. Un des marins de l’équipage, Dong-sik, discute de la différence entre le pademan coréen et le chinois avec une clandestine, le chinois étant plus pimenté. A l’écart, il lui prépare un plat, le ramen. Ce troisième comportement alimentaire est dicté par l’amour. La jeune Chinoise était tombée à l’eau au moment de l’embarquement des migrants. Au péril de sa vie, le marin avait plongé, car la Chinoise l’avait ému. Par la suite, Dong-sik se révoltera contre la pratique sacrificielle de son capitaine. Il fait preuve d’humanité, mais ce regard envers les autres est dû à l’effet produit par l’autre sexe.
Ici ce n’est pas tant la gastronomie qui signifie l’humanité, les autres marins n’ont pas l’air de manger de mauvais plats. Mais c’est le discours gastronomique, le souci de partager un plat qui en est la manifestation.
L'armée des ombres

L’armée des ombres (1969)
Réalisateur: Jean-Pierre Melville
Billet de Vincent Chenille
Ressortie de L’armée des ombres (1969) de Jean-Pierre Melville.
Situé dans la résistance française pendant l’occupation, le film insiste sur la consommation de boissons chaudes, (eau, café), à un moment où la pénurie n’est pas seulement alimentaire mais touche aussi au fuel, au charbon, et qu’il convient de se réchauffer de toutes les façons. Le marché noir et les tickets de rationnement sont bien sûr de la partie.
Une scène à ce propos est particulièrement intrigante. Jean-François Jardie, résistant novice, se rend chez son frère Luc Jardie, qui le retient à déjeuner. Ce qui est intrigant, c’est que Luc Jardie a des tickets pour le beurre et le fromage, mais n’en a pas pour le pain. Il en a pour des mets difficile à avoir, mais pas pour l’aliment de base. « Tu te débrouilles mal » lui dit son frère, lui donnant des tickets de pain qu’il a à la pelle. Ainsi chaque frère a donné sa part dans le repas. Mais ce qu’ignore le jeune résistant, c’est que son frère, qui se débrouille si mal, est son chef de réseau. Ainsi le repas est partagé, mais une hiérarchie est respectée. Jean-François a le pain, car il est le résistant de base et Luc a le beurre et le fromage, car il est un résistant plus rare.
Les mentions de valorisation sociale traduites par le beurre sont fréquentes durant cette période, qui pourtant commence à faire la lutte au gras.
Par exemple, dans César et Rosalie (1972) de Claude Sautet, les protagonistes mangent au restaurant. César y exige du beurre dur tout en montrant un paquet d’argent à Rosalie, susceptible d’acheter le restaurant. César a réussi et il le montre de toutes les façons.
Chappie

Chappie
Réalisateur: Neill Blomkamp
Billet de: Vincent Chenille
Pas beaucoup de mentions alimentaires dans ce film très poétique, mais une qui est significative. Le robot Chappie ouvre le frigidaire du foyer, en sort une bouteille de lait, l’inspecte. Il ne la boit pas, mais la fait couler par terre. On comprend bien qu’un robot n’ait pas besoin de boire ou de manger. Mais pourquoi le réalisateur ne se contente-t-il pas de montrer son robot sans scène de nourriture et met en scène le robot Chappie jetant du lait ? Sans être un personnage de comédie, ce robot a des côtés amusants (comme ses antennes en oreilles de lapin). Néanmoins le film développe toute une philosophie mystique, quant au corps et à l’âme, qui laisse à penser que ce lait jeté n’est pas un hasard. Chappie explique, au cours du film, qu’à la mort, l’âme s’échappe du corps. Elle est immortelle, alors que le corps humain est périssable. Ce n’est pas le cas du corps de Chappie qui est en titane, et donc facilement réparable. Seulement au début du film Chappie n’a pas d’âme. Il n’est qu’un robot-policier d’intervention dont les missions sont programmées. Mais voilà que son concepteur réussit à synthétiser un système nerveux dans un programme. Chappie se retrouve donc doté d’une âme avec un corps immortel. Et, pour le réalisateur, les conséquences de cette dotation sont positives, puisque Chappie fait preuve d’humanité davantage encore que les humains, car il ne craint pas de risquer sa vie pour accomplir ce que lui dicte son cœur. Pour l’auteur, notre corps mortel, qui a besoin d’être nourri, est un obstacle à l’accomplissement de notre humanité. L’avenir n’est cependant pas aux robots. Grâce à un casque informatique qui permet de recueillir les données du cerveau, les âmes des mourants sont sauvée,s puis transférées dans un corps immortel en titane.
Bien sûr, le programme informatique qui recueille les âmes, ou qui les synthétise, n’existe pas. Cependant la vision développée n’est pas qu’une chimère fantastique. A l’heure où la chirurgie et l’électronique remplacent des pans entiers du corps humain, Chappie apparaît comme un horizon possible : plus de corps humain, plus de problèmes digestifs, mais quid de la sensibilité au goût ? Notre humanité existe-t-elle toujours si cette sensibilité-là disparaît ? D’autres films de robots, autres que Chappie, ont répondu différemment à cette question. Par exemple, dans A.I ., le film de Steven Spielberg (2001), l’enfant-robot veut absolument manger, pour être considéré tel un enfant humain comme les autres.
Le corps mystique : Hungry hearts

Hungry hearts
Réalisateur: Saverio Costanzo
Billet de: Vincent Chenille
Après des films comme Noé ou Le parfum de la carotte, qui faisaient la promotion de la consommation végétarienne, il était logique de voir s’affronter herbivores et carnivores. Dans Hungry hearts, ils s’affrontent autour d’un nouveau-né, sur la façon de le nourrir. En toute logique, c’est la mère qui défend le courant végétarien, alors que le père est du côté de celui de la viande. Le film penche en faveur du père, qui, pour finir, se retrouvera avec la garde de l’enfant. Au reste, le père se montre a priori moins sectaire, car il laisse au départ sa femme nourrir l’enfant comme elle le souhaite. Cependant, le fait que son fils ne grossisse pas et ne grandisse pas le pousse à l’emmener chez le médecin, malgré l’opposition de son épouse. La femme est une végétarienne au sens strict, puisqu’elle est même végétalienne : elle refuse les produits issus des animaux, comme les œufs et le lait. Elle nourrit son fils avec des oléagineux, de l’avocat écrasé. Malgré le diagnostic du médecin - rachitisme - elle continuera à nourrir son fils de la sorte. Et lorsque le père nourrira clandestinement le bébé avec des extraits de volaille et de veau, pour le sauver de son rachitisme, elle fera absorber des huiles à son fils pour l’empêcher de digérer la viande.
Pour autant le film ne se présente pas comme misogyne. C’est la grand-mère qui s’opposera frontalement à la mère pour sauver son petit-fils. Le film ne donne pas une seule explication au comportement de la mère, mais plusieurs : la première est d’ordre diététique, pour purifier le corps de l’enfant. La seconde est d’ordre religieux. La mère qualifie son fils d’enfant indigo. Il s’agit d’une croyance des religions du Nouvel Age, concernant l’existence d’enfants élus dégageant une aura couleur indigo. Il y a une explication également de compassion vis-à-vis des animaux. Alors qu’elle est enceinte, la mère fait le rêve d’un cerf tué par un chasseur, et le considère comme prémonitoire. Elle a donc un régime végétalien dès sa grossesse.
Le fait de ne pas donner une explication plus qu’une autre a pour conséquence que le souci diététique, la croyance religieuse et l’empathie animalière sont mis dans un même sac comme étant susceptibles de provoquer des dérives alimentaires. L’explication animiste peut facilement être écartée étant donné que la mère met à l’index d’autres aliments que ceux associés à l’animal (le médecin recommande de donner des légumes à l’enfant). C’est le fait même de manger qui semble lui poser problème, car non seulement le choix est restreint, mais la quantité également (elle n’essaie pas de compenser le manque de protéines animales par beaucoup de végétaux). Et ceci corrobore une dernière explication donnée dans le film. « Elle est folle », dit la grand-mère. Le jugement est tranché, mais il a le mérite de mettre en lumière d’autres comportements de ce personnage, et cela dès le début du film. Elle est incommodée par l’odeur sortant des toilettes de son futur mari. Chose assez commune, mais ceci s’ajoute au fait qu’en coupl,e elle refuse qu’il jouisse en elle (vous avez compris que c’est un film qui concerne les enfants, mais qui n’est pas pour les enfants). Enfin, elle refuse toute césarienne au moment de son accouchement. Elle est obsédée par sa pureté intérieure et craint tout ce qui pourrait la polluer. Cette explication psychologique peut s’appuyer sur un vécu, un problème parental, même s’il n’est pas détaillé dans le film : elle n’a pas connu sa mère et ne s’entend pas avec son père, qu’elle ne voit plus. C’est l’explication la plus plausible, la plus rationnelle, mais le film n’est absolument pas didactique. Aussi la diététique, le mysticisme, l’animisme ne sont pas exclus. Si la mère est séduite par ces théories c’est qu’elles apportent une légitimité rationnelle ou pseudo scientifique à sa névrose. Une légitimité qui emporte au départ, si ce n’est l’approbation, au moins l’acceptation du père jusqu’au malaise. Pour l’auteur, le sectarisme est à même de séduire les cerveaux les plus fragiles psychologiquement.
Sortie DVD/Blue Ray mai 2015
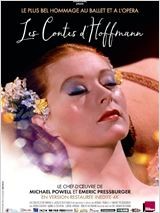
Les contes d’Hoffmann
Réalisé en 1951 par Michael Powell et Emerich Pressburger
Billet de: Vincent Chenille
<
« A nous ta bière, à nous ton vin ». Les contes d’Hoffmann, réalisé en 1951 par Michael Powell et Emerich Pressburger est donc réédité en vidéo. D’après l’opérette de Jacques Offenbach, ce film britannique est donc l’adaptation cinématographique d’une œuvre musicale d’un Allemand naturalisé Français. Le choix n’est pas hasardeux : spécialistes du film de propagande pendant la Seconde guerre mondiale, les deux réalisateurs anglais ont poussé à la réconciliation après-guerre. L’alimentation est un exemple manifeste de cette volonté. Les étudiants réunis dans la taverne réclament une boisson plutôt allemande, la bière, et une plutôt française, le vin (à l’image de la double origine d’Offenbach). Powell et Pressburger réitèreront cette volonté cinq ans plus tard dans La bataille du Rio de la Plata, film décrivant les combats navals en 1939 entre les Allemands et les Anglais. Le capitaine allemand arraisonne un bateau marchand britannique et, par sympathie envers le capitaine prisonnier, il lui offre un verre de scotch. Les contes d’Hoffmann contient encore bien d’autres mentions alimentaires, notamment lors d’un banquet vénitien où tout le monde mange et surtout boit, sauf Olympia, la femme qui fait l’objet de toutes les admirations et qui se révèle être une poupée mécanique.
Film - Repas de famille

Un repas automnal
Réalisateur : Pierre Henry Salfati
Billet de Vincent Chenille.
Il s’agit d’un repas automnal dans le midi de la France. On y boit le pastis et le rosé, mais là s’arrête à peu près l’aspect méridional des denrées, car on y mange du foie gras et du gigot. Il y a bien du mouton dans les Alpilles, mais cela n’a rien de typique de la région.
En revanche, tous les aliments, les plats, sont rattachés à un personnage, Pozzo. Il s’agit bien d’un repas où tout le monde mange et boit, mais ce personnage de maire de droite est le dénominateur commun des aliments. Le poisson tout d’abord, car il prépare sa campagne électorale et a besoin d’un défilé de majorettes. Or la chef de file des majorettes, c’est la poissonnière. Le pastis, le rosé, c’est lui. Il a fait installer un distributeur automatique de chaque boisson dans sa propriété. Sa belle-sœur l’utilise malencontreusement pour son médicament, croyant y mettre de l’eau. De même qu’il a fait installer un four à programmation vocale, dans lequel cuit le gigot à la broche. Un four qui programme la cuisson du morceau dans vingt ans, avant qu’un technicien ne vienne réparer la carte- mère. Mais l’heure du repas est franchement décalée malgré tout.
Le film ne se cantonne pas à montrer les soucis domestiques nés de la modernisation technologique. Il montre comment les nouvelles technologies peuvent perturber les rapports, les communications, que ce soit à la cuisine ou ailleurs. Pozzo sera démasqué par un message compromettant sur Facebook. D’autres situations, où la question technologique ne se pose pas, viennent perturber la sociabilité du repas. Ainsi Pozzo prend-il un malin plaisir à faire manger du foie gras à son beau-frère et sa belle-sœur, sachant qu’ils sont écologistes. Pervers, il leur rappelle en mangeant que le foie gras d’oie est une sorte de cirrhose : « c’est étonnant comme c’est bon ». Perturbation par la technologie, perturbation par la politique, perturbation par la vie conjugale. C’est le couple de gauche qui est en crise, mais c’est Pozzo qui trompe sa femme avec… la fromagère.
Repas de famille fait partie des films à règlements de compte familiaux, comme Festen (1998) de Thomas Vinterberg ou Week end en Famille (1995) de Jodie Foster. Mais nous ne sommes pas dans le mélodrame ni dans la tragédie. Nous sommes dans la comédie. Du point de vue alimentaire, il est pourtant plus détaillé que ses prédécesseurs. Il y montre plus franchement les aliments, particulièrement le gigot et le fromage, qui ont droit à plusieurs gros plans. La gastronomie y a davantage d’importance, mais elle n’y est pas nécessairement bénéfique, puisqu’elle est source de divisions. C’est Pozzo qui est à l’origine de ces fâcheries et c’est lui qui est le point d’attache des aliments. Ce n’est pas innocent : il est le véhicule de l’identité nationale. Parce qu’il est le maire, qu’il a installé La Marseillaise comme sonnerie de portable et qu’il fait un doigt d’honneur aux gens du voyage. Le poisson, le pastis, le foie gras, le gigot, le rosé contribuent à son identité nationale, sauf… le fromage. Car il s’agit d’un parmesan. Le fromage rappelle que, malgré son chauvinisme, Pozzo est d’origine italienne.
L’identité nationale disparaîtra lorsque, confondu par ses trahisons, Pozzo sera contraint de partager le gigot avec les gens du voyage. Le gigot présente l’avantage d’être un morceau parfaitement identifiable avec lequel il est possible de faire des parts égales (ce qui n’est pas possible avec la volaille) et qui convient à toutes les confessions. Repas de famille n’est donc pas aussi radical que Gemma Bovery, le film d’Anne Fontaine, pour qui la culture et, en particulier la gastronomie, devenait mortelle. Mais elle est incontestablement source de problèmes dans Repas de famille, sauvée in extremis par le gigot.
Discount

Un supermarché contemporain
Réalisateur: Louis-Julien Petit
Billet de Vincent Chenille
Ce film raconte la vie d’un supermarché contemporain dans une ville du nord de la France (les maisons sont bien alignées). Et bien que l’on trouve de tout dans un supermarché, les aliments sont particulièrement mis en scène dans ce film. L’histoire est celle d’une restructuration du personnel avec l’arrivée prévue des caisses automatiques. Le point de vue social y est donc privilégié, mais la fiction n’y est pas absente. Car les employés les plus menacés par la restructuration du magasin décident de doubler leur mois (et plus) avant le licenciement, en créant un magasin discount parallèle, sur un circuit lui aussi parallèle, car il s’agit de marchandise dérobée.
Les produits dérobés font partie des invendus que le magasin détruit habituellement. L’enseigne Discount ne laisse pas glaner les passants. Les barquettes, cartons et tous produits sous emballages, ainsi que les fruits et les légumes frais, sont piétinés dans un caisson par le personnel, avant d’être aspergés d’essence. Le film, bien entendu, montre l’énorme quantité de marchandise gaspillée, mais il fait aussi un parallèle entre les aliments et le personnel mis au rebut, car il n’y a que ces personnages qui, à l’écran, accomplissent cette tache. Et l’on perçoit bien que, dans ce rebut, aliments comme êtres humains, il y a encore beaucoup de valeur ; d’où un double sentiment de gâchis. Mais les marchandises ne sont pas que des rebuts. Au moment du rangement des rayons, les employés mettent des produits de côté, et le comptable de l’établissement signalera des pertes importantes. Ce qui signifie qu’il y a « fauche ». Les voleurs seront punis, mais emprisonnés la tête haute. Car en vendant en circuit parallèle, dans un hangar, le produit de leur larcin à bas prix, ils constateront qu’en un jour ils sont capables d’obtenir leur paye d’un mois. Autrement dit : si ce sont des voleurs, il y en a de plus gros qu’eux. Leur motif de fierté est d’avoir vendu des produits à des familles dans des difficultés financières et complices de ce larcin, qui leur rendait service. Complices car, à l’arrivée de la police, personne ne dénonce les voleurs. Nous sommes donc dans une fable sociale, de gauche, où les problèmes sont liés à la machine économique et non à des questions ethniques. A ce titre, le film présente des voleurs surtout Européens, même s’il y a un Maghrébin, alors que la gérante de l’hypermarché est Arabe.
Le film offre une idée des circuits courts, même si les produits ne sont pas directement du producteur au consommateur, puisqu’il s’agit d’un circuit partiellement industriel. Mais le réseau des personnes contactées par SMS ou au porte-à-porte ainsi que le dépôt, non pas de paniers, mais de sacs plastique, est bien montré et rend l’histoire de ce magasin parallèle parfaitement crédible. Mais le point le plus important est qu’il nous montre surtout des produits de l’industrie agro-alimentaire au début du film et de plus en plus des produits frais au fur et à mesure que l’histoire avance, bien que tout le magasin soit filmé. Tout est une question de gros plans. Pourquoi cette évolution ? L’un des personnages, Christiane dit au milieu du film : « Il n’y a pas de raison à ce que les pauvres mangent de la merde ». La baisse des prix pratiquée par le magasin parallèle permet l’accès aux plus modestes à des produits frais. Ainsi, au début, le voisin mange une boîte de conserve, les employés des plats cuisinés en barquette au moment de leur pause-déjeuner, et le fils de l’une d’entre elles, de la saucisse avec des lentilles. A la fin, il s’agit de fruits et légumes. Conserves, féculents, plutôt que produits frais : le film repose sur un constat sociologique avéré. C’est pourquoi il est plus crédible que On aurait pu être amies d’Anne Le Ny, sorti il y a quelques mois, et qui plaidait également pour un accès à une alimentation de meilleure qualité pour les plus pauvres.
Sortie DVD-Blue-ray avril 2015

West Side Story (1960)
Réalisateur: Robert Wise
Ressortie de West Side Story (1960), à voir bien sûr pour la musique de Léonard Bernstein, la chorégraphie de Jérôme Robbins, la réalisation de Robert Wise et l’interprétation de Natalie Wood, mais aussi parce que c’est un des films les plus emblématiques de l’image de Coca-Cola au cinéma. Dans le film, elle est la boisson de l’intégration américaine culturelle et sociale. West Side Story raconte l’affrontement de deux bandes de jeunes dans ce quartier new-yorkais, les Sharks et les Jets. Les uns sont portoricains (les Sharks), les autres sont blancs (les Jets). Il s’agit donc d’un affrontement racial qui ira jusqu’à la mort de Tony, un protagoniste blanc amoureux de Maria, la portoricaine. Ils ont malgré tout un point commun, ils boivent tous du Coca-Cola. Ils organisent leur affrontement au bar de chez Doc et décident que ce sera « Coca-Cola pour tout le monde ». Le bar et la boisson sont les seuls lieux où ils peuvent se retrouver « pacifiquement ». Il s’agit aussi d’intégration sociale car le blanc Tony ne fait plus partie des Jets, il ne combat plus depuis qu’il a trouvé du travail. C’est justement chez Doc qu’il travaille. Il y transporte des caisses de Coca-Cola. « Sais-tu combien il y a de bulles dans une bouteille de Coca-Cola ? », dit-il au chef des Jets, en lui conseillant de travailler. Tout le monde est inclus dans la bouteille, à travers cette métaphore. Le gendarme, interprété par Louis de Funès, parodiera West Side Story dans Le gendarme à New York de Jean Girault. Mais ce ne sera pas autour d’une bouteille de Coca-Cola que les Français se retrouveront, mais autour d’un steak.
Billet de Vincent Chenille

Sortie d’Interstellar de Christopher Nolan, que nous avons chroniqué en fin d’année.
The Boxtrolls

Film d’animation
Réalisateurs : Graham Annable, Anthony Stacchi
Billet de Vincent Chenille
Ce film d’animation se situe à Cheesebridge, une cité du fromage, dirigée par Lord Belle-Raclette ; une cité où le fromage compte davantage que les enfants. Car lorsque Trappenard annonce à Lord Belle-Raclette qu’un enfant a été enlevé par les Boxtrolls, le dirigeant ordonne de s’en occuper demain. Mais dès que Trappenard affirme que les Boxtrolls vont venir voler les fromages, Belle-Raclette décide que les Boxtrolls soient pourchassés sur le champ. De même l’argent amassé pour la fondation d’un orphelinat est-il réorienté vers l’achat de la meule impériale (meule géante bien entendu). Les Boxtrolls sont des êtres qui vivent dans les sous-sols et qui portent une boîte sur leur cage thoracique comme vêtements ; comme tous les trolls ils sont de petite taille. Ils ont la réputation d’être anthropophages et de manger des rats, comme ils vivent dans les sous-sols. C’est uniquement une réputation car le spectateur peut observer qu’ils ne sont en rien cannibales mais mangent des chenilles et des bêtes à bon dieu. Certes ils mangent avec leurs doigts, alors que la population choisie de Cheesebridge mange son fromage avec des couteaux, des assiettes et des fourchettes. Un petit garçon, élevé par les Boxtrolls, scandalisera la bonne société de Cheesebridge en se goinfrant de fromage avec les doigts. Voyant sa bévue il recrachera le tout et mangera son fromage prédigéré avec la fourchette.
La bonne société de Cheesebridge vit persuadée de sa valeur, « nous sommes le bien », parce qu’elle est raffinée dans son alimentation et qu’elle se persuade de la réputation épouvantable des Boxtrolls, sans penser qu’en privilégiant l’accessoire (le fromage), à l’essentiel (les enfants), ils en deviennent monstrueux. Il s’agit bien sûr de distinction sociale par l’aliment, en l’occurrence le fromage. Le choix de l’aliment peut paraître curieux car il est rarement présent à l’écran et parce qu’aujourd’hui dans le moindre magasin discount on trouve du fromage. Aussi l’honorable société de Cheesebridge est-elle située à la fin du XIXe siècle, début du XXe (les hommes portent le haut de forme et il n’y a qu’une seule voiture motorisée). Le siècle explique la rareté du produit, mais ça n’explique pas pourquoi une production cinématographique, importante financièrement, choisisse de représenter un aliment si rare à l’écran.
Bien des fromages sont nommés, et le travail de leur apparence a été particulièrement soigné pour le rendre réaliste : gruyère, bleu , roquefort, cheddar, munster. Les appellations véhiculent en même temps les pays : Suisse, France, Allemagne, toutes les régions montagneuses d’Europe et bien entendu la Grande-Bretagne, puisque le dirigeant de Cheesebridge est un lord. Cette société de classe est européenne, et l’accès à son cercle suscite des monstruosités puisque Trappenard accepte d’exterminer les Boxtrolls afin d’intégrer la classe des mangeurs de fromage, bien qu’il soit allergique à l’aliment. Peu adeptes du fromage les Américains se moquent, et critiquent, la société européenne de classe avec The Boxtrolls. Mais ce n’est pas la seule raison du choix du fromage.
Pour exterminer les Boxtrolls, Trappenard oblige un scientifique à mettre au point une machine dans laquelle les créatures finissent brûlées dans un four. C’est bien sûr de la Shoah dont il s’agit. Dès lors les Boxtrolls qui vivent dans des sous-sols avec leurs boîtes sur le torse peuvent être lus comme les juifs obligés de porter l’étoile jaune et à vivre dans des ghettos. Ils se distinguent de la société de Cheesebridge, parce qu’elle mange des aliments fermentés (la moisissure du bleu a une odeur de betterave. Or le judaïsme interdit l’emploi de pressure animale pour les fromages) et parce qu’il n’y a pas de mères (Lord Belle-Raclette pas plus que Trebshaw, le père du héros, n’ont d’épouses). Nous sommes dans une société patriarcale et non matriarcale. La sortie de cette monstruosité passera par la naissance du couple Trebshaw avec la fille de Lord Belle-Raclette et le héros qui poussera les Boxtrolls à arracher leurs boîtes.
Sorties DVD mars 2015
Les gens de Dublin
Réalisateur : John Huston
D’après une nouvelle de James Joyce.

L’action se déroule lors du réveillon de Noël chez des bourgeois irlandais. Le film date de 1987, qui est la décennie où l’on trouve le plus de références de dindes de Noël au cinéma : entre autres dans Mille milliards de dollars d’Henri Verneuil en 1981, dans Le père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré en 1982, dans Travail au noir de Jerzy Skolimowski en 1983 ou dans Neuf semaines et demie d’Adrian Lyne en 1986 ; des films de genres très différents. Pourtant ce n’est pas de la dinde qui est servie lors de ce réveillon irlandais, mais de l’oie. Les hôtesses, les demoiselles Morhan, n’aiment pas la dinde qui, disent-elles, ressemble à de la viande essorée. Ce film est à contre-courant à tout point de vue. Le réveillon de Noël, avec la dinde, destiné à fêter la nativité, se transforme en un réveillon avec de l’oie, marqué par la mort d’un homme.
Blanche neige
et les sept nains
Le premier long métrage animé de Walt Disney.

La scène de la pomme empoisonnée offerte par la sorcière est un classique. Damnation née d’une pomme, Blanche neige inverse la malédiction de la Genèse. C’est le couple qui lève la malédiction, par l’amour, alors que dans la Bible, c’est le couple Adam et Eve qui franchit l’interdit et est chassé du jardin d’Eden. En dehors de la pomme, on parle beaucoup de beignets, de tartes et de massepains dans Blanche neige, mais c’est la soupe qu’on mange. Destiné avant tout au jeune public, le dessin animé se devait d’être éducatif. Il a fait école.

Gemma Bovery
Réalisateur : Anne Fontaine
Déjà chroniqué, il sort en DVD ce mois.
Chef

La saucisse fumée de La Nouvelle Orléans
Réalisateur : John Favreau
Billet de Vincent Chenille
Sorti en novembre, Chef est le second film américain en deux mois à parler d’authenticité quant à la cuisine. Ici l’authenticité passe par un savoir-faire local (alors que dans Les recettes du bonheur, c’était plutôt l’inverse, il s’agissait de terroir). Le savoir-faire local, ce sont la saucisse fumée de La Nouvelle Orléans, bonne sur les marchés, mais meilleure à La Nouvelle Orléans, ou du manioc grillé dans le quartier cubain de Miami, ou de la grillade texane, dont la particularité est que la cendre doit se consumer pendant toute la nuit.
John Favreau nous invite à ce parcours, dont l’authenticité est garantie par un food truck. Le chef se déplace et peut ainsi obtenir sur place les produits authentiquement préparés pour les intégrer dans ses sandwichs. Cette authenticité par les pratiques ne l’empêche pas d’être créatif en associant par exemple le plantain dans le sandwich cubain traditionnel. Il trouve même davantage de créativité dans cette cuisine itinérante que dans le restaurant gastronomique, dont il était le chef, où il était contraint de préparer tous ses classiques : l’œuf au caviar, les Saint-Jacques, le moelleux au chocolat. On l’aura compris, le film défend les cuisines locales américaines, plutôt qu’une cuisine internationale (le moelleux, la Saint- Jacques se retrouvent à la carte de tous les restaurants gastronomiques occidentaux). Ce passage d’une cuisine à l’autre, comme dans On aurait pu être amies, se traduit par un changement de compagne. Mais si dans le film français le chef passait de la femme légitime à la maîtresse, dans Chef le parcours est inverse.
L’opposition entre cuisine locale, régionale et cuisine internationale n’est pas nouvelle et se défend, mais l’aspect plus créatif de la cuisine par la confection de sandwichs plutôt que par la cuisine gastronomique laisse perplexe. De fait, le réalisateur John Favreau essaie de traiter en osmose la cuisine et le cinéma. Mais il n’y arrive pas complètement. Réalisateur de blockbusters, de grosses productions américaines comme Iron man, Iron man 2 et Cow boys et envahisseurs, John Favreau réalise avec Chef une petite production. Une petite production qui est également une mise en abyme puisqu’il y tient le rôle principal. Le chef et le réalisateur ne font qu’un. Et lorsque le chef témoigne du bonheur retrouvé à cuisiner ses sandwichs plutôt qu’à travailler dans le restaurant gastronomique, c’est, bien sûr, le bonheur créatif retrouvé du réalisateur John Favreau travaillant sur une petite production plutôt que sur de grosses machines, où le cahier des charges est très contraignant, et où les réalisateurs doivent obéissance aux producteurs qui veulent des produits calibrés d’après des études de marketing. Le parallèle n’est pas totalement absurde et bien des grands chefs se sont retrouvés étiquetés, après des plats qu’ils avaient réalisés avec bonheur, ayant quelquefois des difficultés pour proposer autre chose sur la carte. Néanmoins, je n’ai pas connaissance d’un problème un peu général entre chefs de cuisine et propriétaires de restaurants, les premiers essayant d’innover et les seconds imposant les classiques, parce que ce sont eux qui tiennent les cordons de la bourse. Ce problème existe dans la production cinématographique américaine, pas dans la gastronomie.
Où le parallèle fonctionne bien, c’est concernant le pouvoir de la critique qui a la possibilité de briser des réputations, ruiner des carrières ; davantage encore aujourd’hui avec l’immédiateté de l’internet. C’est ce qui est arrivé au cuisinier John Favreau dans Chef, qui s’est pris de bec avec un critique gastronomique sur les réseaux sociaux. Souhaitant donner libre cours à sa créativité, il est contraint aux sandwichs, car les autres restaurants ne veulent plus l’engager à cause de sa réputation sur la toile. Mais, dans le fond, le chef Favreau, le cuisinier et le réalisateur, n’est pas contre les critiques qui lui ont été faites : elles sont le résultat de la politique normative du producteur, alors que John Favreau voulait élaborer un repas plus créatif. Mais il ne supporte pas le langage des critiques, surtout leur radicalité accentuée par l’immédiateté. La scène où John Favreau défend le repas classique, la grosse production, qu’il avait lui-même critiqué en cuisine, parce que c’est du travail malgré tout, est sans doute la meilleure du film.
C’est pourtant cette scène qui a valu à Chef d’être éreinté… par la critique !
Actualité Dvd & Blue RAY (2015 02)

Les Sept Samouraïs (1954)
d’Akira Kurosawa
Un classique du cinéma japonais et du cinéma d’aventure. Avant l’ère Meiji, un groupe de bandits vient piller un village de paysans, emportant la récolte de riz. Réduits à s’alimenter de gruau et de millet, les paysans font appel à des samouraïs pour se protéger des bandits. C’est en riz qu’ils paieront ces guerriers affamés.
Etant un classique, il n’est pas besoin de motifs particuliers pour ressortir Les Sept Samouraïs. Cependant, le succès d’une série de films héroïques, comme Hunger games, dont l’enjeu dramatique est celui de la faim, n’est probablement pas étranger à cette ressortie. Les Sept Samouraïs est cependant un film des années cinquante, où l’on ne peut pas parler de crise, même si la situation est critique, mais de problèmes de dénutrition après la Seconde Guerre mondiale. Avec ce riz, compté grain à grain, afin de savoir s’ils ont de quoi subvenir et payer les samouraïs, et en montrant aussi ces marchands de restes, Les Sept Samouraïs est une oeuvre très représentative de cette décennie cinématographique, où les céréales et les restes furent particulièrement à l’honneur.

La Party (1969)
de Blake Edwards
Autre classique, de la comédie cette fois, La Party raconte l’histoire d’une soirée donnée par un nabab d’Hollywood. Au cours de cette soirée est donné un dîner riche en gags alimentaires : acteur se tartinant la main au lieu du pain, poulet glissant dans la chevelure postiche d’une invitée. Rien n’est jamais gratuit chez Blake Edwards et avec La Party, il explore encore une fois les effets produits par l’alcool.
S’il s’était attaché dramatiquement à l’alcoolisme dans Le jour du vin et des roses, en 1962, avec La Party, il aborde l’alcool dans les milieux de la production cinématographique. Il utilise aussi l’alimentation pour rendre compte des atermoiements politiques et sociaux hollywoodiens. Le producteur, Fred Clutterbuck, offre du caviar pour commencer le repas : une attitude de riche plus proche aux Etats-Unis des mondains européens. A la fin de La Party débarquent les Russes et, pour leur rendre hommage, Mme Clutterbuck propose de leur porter un toast avec de la vodka. Avec les mêmes ingrédients, la soirée passe du capitalisme au communisme.
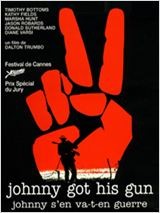
Johnny s’en va-t-en guerre (1971)
de Dalton Trumbo
Ressorti probablement à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, ce film témoigne de Joe Bonham, soldat américain, grand blessé de guerre en 1917. Suite à ses blessures, Joe est nourri par une canule. Espérant un jour remanger autrement, normalement, il se souvient d’avant : de Noël, lorsque son père découpait la viande à la scie pour le repas familial, du buffet offert par son patron, où il y avait du champagne et des gâteaux ; un film poignant, implacable.

Hard day’s night
Quatre garçons dans le vent (1964)
de Richard Lester
Première comédie musicale réalisée avec les Beatles, Hard day’s night est un faux reportage sur une tournée du plus célèbre groupe de pop britannique. L’alimentation sert de clin d’œil envers le spectateur pour lui dire que nous sommes dans le faux : un acteur sur le tournage d’un film en dépose sur son plat, avant de l’utiliser comme blessure de guerre pour la scène qu’il va tourner. L’aliment sert à l’œuvre plastique, nous sommes bien dans le Pop art. Autrement, le film joue avec les symboles alimentaires, ceux du groupe et ceux de l’Angleterre. Ainsi George Harrison mange-t-il un hamburger, et c’est à Hambourg que les Beatles ont adopté la célèbre coiffure qui leur a valu nombre de commentaires. Le réalisateur filme beaucoup le lait à Londres, et l’on sait que la livraison matinale du lait est une tradition londonienne. Mais un des personnages-clés du film en boit avec des tranquillisants. Autrement dit, à Londres, en 1964, on consomme du lait, mais aussi de la drogue.

Aguirre, la colère de Dieu (1972)
de Werner Herzog
Ce film de conquistadors, qui dérivent sur l’Amazone sans pouvoir se ravitailler, en partie à cause des cannibales, traite de l’alimentation davantage d’un point de vue social qu’ethnique, ce à quoi on aurait pu s’attendre cependant. La scène la plus impressionnante est celle où les soldats lèchent le sol à force d’avoir manqué de sel. Car tout est rationné, tant qu’il n’est pas possible d’accoster : le sel et le maïs. Celui qui dépasse le quota est tué. Mais le traitement est différent pour Guzman, le chef d’expédition. Lui a droit à des fruits frais consommés tels quels ou utilisés pour donner du goût à un poisson qui manque de sel. Les fruits font partie des réserves de l’expédition, mais ils sont aussi volés à l’occasion d’une descente à terre.
Gemma Bovery

"Fausse route"
Réalisatrice : Anne Fontaine
Billet de Vincent Chenille
Gemma Bovery raconte l’histoire d’un couple de britanniques installé en Normandie, de nos jours, vu à travers le regard du boulanger du village. Et, bien sûr, il y est pas mal question de pain. Deux optiques sont proposées au spectateur, une érotique et une patrimoniale.
A la différence d’On aurait pu être amies, sorti cet été, la nourriture n’est pas un substitut aux scènes érotiques. On y voit bien des scènes d’amour. Cependant la nourriture joue le rôle de substitut pour le boulanger (il appelle ça son « yoga »). Des hommes désirant Gemma (Patrick, Charlie, Hervé et Martin), il est le seul à ne pas avoir de scène d’amour. Il n’essaie pas de la posséder, mais il lui propose de lui apprendre à pétrir la pâte. Gemma malaxe donc avec délice la pâte à pain ; à ses côtés, un Martin voyeur en plein émoi, tout comme lorsqu’il voit Gemma exprimer sa jouissance en goûtant ses pains dans la boutique, particulièrement le pain au tournesol et la croquinette.
Pourquoi Martin ne se montre-t-il pas entreprenant avec Gemma ? On peut penser à l’âge, étant donné qu’il est le plus vieux des quatre hommes. Mais il avance une raison culturelle. Très érudit, ayant travaillé auparavant dans l’édition, le boulanger Martin voit en Gemma Bovery la réincarnation d’Emma Bovary en cette Normandie si chère à Flaubert, et, pour lui, cette histoire d’adultère ne peut se terminer qu’en suicide par empoisonnement. C’est son point de vue, mais la cinéaste Anne Fontaine nous livre un autre portrait de la jeune femme : elle ne s’ennuie pas, elle réussit à se réconcilier avec son mari malgré l’adultère, elle ne désire plus Hervé ni Patrick, mais elle meurt par faute des anciens amants et mari tout disposés à s’écharper pour elle. Sa mort reste alimentaire : une fausse route. « Madame Bovary, c’est moi » disait Flaubert et Anne Fontaine reprend l’adage au pied de la lettre. Le narrateur du film c’est le boulanger Martin, tout comme Flaubert était le narrateur de Madame Bovary. Madame Bovary dans le film, c’est donc Martin et non Gemma Bovery. C’est lui qui s’ennuie et qui imagine des histoires avec Gemma d’abord, puis avec celle qui emménage après elle et qu’il prend pour Anna Karenine. On comprend également qu’il n’a plus de relation au lit avec sa femme et que ses émois sexuels il les vit à travers la boulangerie qu’il a reprise ainsi qu’à travers la littérature. Il a une relation patrimoniale.
L’aspect patrimonial culturel de la cuisine est en effet abordé dans le film et pas seulement à travers le pain. Le cidre est là pour nous rappeler la Normandie, mais, plus globalement, il est traité à travers un parallèle entre deux personnages féminins : Gemma Bovery et Wizzy. Les deux femmes sont mariées à des britanniques mais Wizzy est d’origine française. Cependant, autant Gemma apprécie la France, autant Wizzy est tournée vers la Grande-Bretagne. Gemma mange tous les pains français et boit du calva, mais de plus elle refuse de faire un curry à ses invités français, comme le lui avait suggéré son mari, car elle ne veut pas d’un plat qui emporte la bouche. Gemma n’aurait donc pas pu aller dans le restaurant français du cuisinier des Recettes du bonheur. Wizzy, quant à elle, ne mange pas les produits du village normand et elle fait venir son alimentation de Londres. Elle mange du pain light et conseille à Gemma de perdre ses bourrelets. Végétarienne, elle ne goûte pas au plat de viande préparé par Gemma pour les Français. Elle est soucieuse de sa ligne, et, à la différence de Gemma, elle n’affiche effectivement aucune rondeur. Est-ce pour plaire à son britannique de mari ? On peut en douter, car au cours d’une discussion animée avec Martin, celui-là dit qu’il aime « la France et les produits français » (sous-entendu, ce sont les Français qu’il n’aime pas). Wizzy a peut-être des questions à se poser sur la fidélité de son mari. Toujours est-il qu’elle semble se conformer à un modèle culturel anglo-saxon plutôt qu’aux desiderata de son mari. Un modèle qu’elle s’empresse de diffuser auprès de Gemma qui, sensible, s’y conformera en faisant un régime.
Ces débats sont secondaires, comme les personnages, dans le film. La réalisatrice Anne Fontaine n’entend pas faire un film sur les mérites respectifs des diététiques française et britannique et y développer un point de vue personnel. Son sujet, c’est Gemma, une jeune femme qui, au bout du compte, se trouve être une victime, puisqu’elle meurt. Elle meurt victime d’une fausse route, une bouchée de pain qui bouche son canal respiratoire plutôt que d’aller vers l’estomac. Elle meurt victime des a priori, mais à travers la miette de pain, à travers la vision bovarienne de Martin et puritaine des anglo-saxons, la culture se trouve réduite à des a priori.
Interstellar

Terres en poussière
Réalisateur : Christopher Nolan
Sortie : novembre 2014
Billet de Vincent Chenille
Nouvel opus américain où la famine est l’enjeu dramatique. Le problème n’est pas dû dans le film à la crise financière, bien que les images de nuages de poussière très présents rappellent les dust bowls de la crise de 1929 : lorsque les agriculteurs ruinés par la crise abandonnaient la terre, et que celle-ci faute d’être cultivée partait en poussière. Dans le film, c’est plutôt l’épisode de désert égyptien qui fait référence. Lorsque l’empire romain sollicitait un peu trop les pays conquis, et particulièrement l’Egypte pour produire du blé, afin de nourrir les légions romaines. A force d’avoir été sollicitées, les terres devinrent du sable.
Avec Interstellar, Christopher Nolan part de ce postulat de trop grande sollicitation de la terre. Constat réel, puisque, étant donné le développement et de la démographie et du niveau de vie dans les pays émergents, une planète et demie serait nécessaire pour satisfaire ces besoins, alors que nous n’avons pour l’instant à disposition qu’une planète. Le blé est le premier à disparaître dans ce film, détruit par le mildiou. Le maïs arrive à se maintenir, parce qu’il retient davantage l’eau, mais le Pr Brand assure qu’il est aussi appelé à disparaître. Le diagnostic du film est que la conquête spatiale, si elle permet éventuellement de trouver de nouvelles planètes hospitalières pour l’homme, ne pourra sauver l’humanité, car il n’y aurait pas les moyens spatiaux pour emmener tout le monde dans l’espace. Diagnostic qui semble pertinent, davantage que la solution offerte dans le film qui relève plutôt du romanesque.
La famine n’y est pas montrée du point de vue physiologique. On voit surtout des populations fuir les terres qui partent en poussière. Cela étant, lors d’une partie de baseball, on voit le grand-père du héros regretter le hot-dog d’antan. Dans le stade, dorénavant, on ne peut manger que du pop corn, l’élevage nécessitant trop de terres cultivables. Et du baseball sans hot-dog, ce n’est plus vraiment du baseball, dixit le personnage…
Sorties DVD décembre 2014



Under the skin de Jonathan Glazer
Nous l’avons chroniqué cet été. Il vient de sortir en vidéo.
Pierrot le fou de Jean-Luc Godard (1965)
Le fromage est un aliment peu présent à l’écran. Le voir manger est encore plus rare. Pierrot le fou est un des rares exemples, où l’on voit Ferdinand (interprété par Jean-Paul Belmondo) manger à Porquerolles une pâte pressée parsemée de sauces (des taches très décoratives) pour en relever le goût.
Les quatre cents coups de François Truffaut (1959)
Dans ce film sur l’enfance maltraitée, les aliments et les plats sont très basiques : pain, lait, soupe, œufs. Mais comme toujours chez Truffaut, ils ont une valeur symbolique davantage que réelle. C’est le père de famille qui prépare des œufs au plat. Fait notable, car dans la cuisine quotidienne, c’est généralement la femme que l’on voit faisant la cuisine à l’écran. Mais dans Les quatre cents coups, il se trouve que le père de famille n’est pas le géniteur. Le spectateur le découvre au cours du film. La scène de l’œuf est donc liée à la conception de l’enfant. De même, le petit Antoine Doinel, en fugue, vole du lait (la boisson des enfants) pour satisfaire sa faim. Si la soupe reste familiale, le pain témoigne de la dureté de la maison de redressement dans laquelle il est envoyé. Il y reçoit une correction pour avoir mangé son pain avant d’en avoir reçu l’autorisation.
Opération Casse-noisettes

Opération casse-noisettes
Réalisateur : Peter Lepeniotis
Billet de Vincent Chenille
Ce dessin animé raconte les problèmes d’approvisionnement alimentaire rencontrés par les petits animaux d’un parc à New York. Les écureuils Roublard, Grison et Roussette, ainsi que le raton laveur, chef de la tribu, en sont les protagonistes principaux. La tribu partage les ressources alimentaires dans un chêne, à l’exception de Roublard qui joue en franc-tireur. Voulant devancer la tribu en la matière, il va piller un marchand de noisettes. Mais les conséquences en seront l’incendie du chêne par le magasin ambulant du marchand. Roublard sera alors banni de la communauté et devra se débrouiller dans la jungle des villes, hors du jardin. Après des moments difficiles, se retrouvant face à des rats, il finira par trouver l’entrepôt du marchand de noisettes. Mais il devra négocier entre sa part et celle revenant à la communauté, avec Roussette et Grison, qui ont eux aussi découvert la boutique.
Il ne faut pas s’attendre, dans Opération casse-noisette, à des images nombreuses et diverses d’aliments, comme celles des dessins animés Ratatouille ou Tempête de boulettes géantes. Roublard évoque bien les noisettes, cacahuètes, pistaches et autres fruits secs, mais on ne voit guère que des cacahuètes comme aliments dans le film (ainsi qu’un donut consommé par un policier humain). Le propos n’est pas gastronomique, mais alimentaire : il s’agit de pallier une famine et non de contenter son palais. L’alimentation y est choisie pour tenir un discours politique. Il y a tout d’abord un discours de morale civique, classique. Les talents, tels que celui de Roublard pour dénicher les filons alimentaires, doivent se mettre au service de la collectivité. Roublard, qui accepte l’isolement que lui impose le groupe, finira par travailler pour la communauté, la faisant profiter de ses talents non par compassion ou sentiment identitaire, mais parce qu’il a trouvé en Roussette un être débrouillard, qui lui plaît. Et Roussette se trouve être attachée au groupe par compassion. C’est la morale par l’amour qui finit par rattacher Roublard au groupe. Et l’opinion que l’on se fait de Roublard se modifie en conséquence. Au début, pour souligner son côté voyou, son projet de vol alimentaire est mis en parallèle avec une bande d’humains qui préparent un hold-up. Mais l’évolution de l’écureuil va l’amener à s’opposer aux cambrioleurs, car ce sont eux qui tiennent le magasin de noisettes. Ce n’est pas un voleur, il fait cela pour manger. Le renégat va se retrouver justicier. A ce carrefour, c’est un autre animal qui va se trouver en parallèle avec les bandits : le raton laveur, le chef de la communauté. Le message proprement politique se trouve là, car c’est le citoyen qui est interpellé et qui peut agir. Le raton laveur a organisé la famine. Il fait croire que les réserves sont épuisées, alors que ce n’est pas vrai, afin d’obliger la communauté à trouver d’autres ressources alimentaires et, de son côté, utiliser les réserves de façon frauduleuse, en cheville avec des bandits (des rats notamment). Donc le vol est du côté du représentant politique de la communauté, qui fait travailler les animaux sans qu’ils profitent du fruit de leurs efforts. C’est là une distinction de taille, car si le thème de la faim est présent dans les films américains depuis la crise financière de 2007, avec Hunger Games, Noé, jamais le pouvoir politique n’avait été accusé d’organiser la faim. Le problème se trouvait plutôt du côté de l’économie et de la finance. Ce qui classe Opération casse-noisette du côté républicain avec un héros individualiste (Roublard) et une critique de l’impôt, alors que les autres films étaient plutôt radicaux. Transposé aux humain, la fable suggère qu’il n’y a pas de crise financière et que les problèmes de déficits publics ne sont liés qu’à des politiciens qui s’en mettent plein les poches. Et Roublard, qui a un talent pour les schémas, les poulies, les dispositifs, représente l’aspect ingénieux de l’entreprise.
Les recettes du BONHEUR

Les Recettes du BONHEUR
Réalisateur: Lasse Hallström
Billet de Vincent Chenille
Les recettes du bonheur raconte l’histoire d’une famille de cuisiniers en Inde, depuis plusieurs générations, dont le restaurant est incendié, après une élection, par des opposants au vainqueur du scrutin.
La famille décide d’émigrer et choisit le Massif central comme terre d’installation, car elle y trouve autant d’authenticité dans les produits qu’en Inde. Ils établissent donc un restaurant indien et n’hésitent pas à le placer en face d’un autre restaurant étoilé, celui-ci de cuisine française. L’établissement huppé déclarera la guerre à l’Indien (qui répliquera) le privant de l’approvisionnement du marché, demandant des arrêtés d’interdiction au maire pour tapage ou devanture non réglementaire. Cela n’empêchera pas le restaurant indien d’avoir du succès et cela malgré la réputation de l’établissement français.
Un incendie xénophobe scellera la paix entre les deux établissements. Le chef indien Hassan, curieux de la cuisine française, viendra se former dans le restaurant rival et lui permettra d’obtenir sa seconde étoile. Envoyé à Paris, avec la bénédiction de tous, pour s’initier à la cuisine moléculaire, il y obtiendra sa troisième étoile, mais décidera de retourner dans le Massif central, car il s’ennuie à Paris pour une seule raison : il ne trouve pas l’authenticité du terroir dans la capitale. Certes il y revient aussi pour retrouver Marguerite, la sous-chef du restaurant. Mais Marguerite, c’est le terroir : c’est elle qui a accueilli la famille indienne et lui a fait goûter les produits bio qu’elle cultive ; c’est elle aussi qui a initié Hassan à la cueillette des champignons. De retour à Saint-Antonin-Noble-Val, le chef indien retrouvera donc Marguerite, son terroir, son bonheur, avec en poche, en prime, les trois étoiles, c’est-à-dire la réussite. Il aura donc le beurre et l’argent du beurre. Les recettes du bonheur est un film bien fait, car il a l’habileté de mêler tous les thèmes que l’on peut trouver de façon isolée dans les films de fiction qui traitent de gastronomie, avec, au cœur, la question de la mondialisation : la concurrence internationale, la préservation du terroir dans un monde sans frontières, son corollaire de préservation ou d‘évolution du goût, l’intégration des populations étrangères à travers l’alimentation, et, à la clé, les rapports entre cuisine et politique. Tout cela est présent dans le film et, si tout finit harmonieusement, le parcours pour y arriver présente une réalité biaisée. Le film présente la xénophobie française comme une expression de la médiocrité qui ne supporte pas la concurrence. Ainsi, c’est le chef étoilé qui va incendier le restaurant indien et y inscrire « La France aux Français » car l’Indien attire du monde et la qualité de sa cuisine y est appréciée. Il montre aussi comment ce nationalisme est un outil commercial dans la lutte que mène Mme Mallory pour lutter dans un environnement concurrentiel, afin d’obtenir une étoile supplémentaire. Poussant l’excellence jusqu’à refuser une asperge trop molle, elle n’hésite pas à répandre l’idée que la cuisine indienne n’est pas civilisée (à cause de l’usage abondant d’épices).
Curieusement, elle commence à assaillir son concurrent avant qu’il n’ait ouvert, preuve d’un esprit commercial acharné. Elle ira jusqu’à dénigrer un pigeon aux truffes réalisé par Hassan, alors qu’elle sait qu’il est bon, uniquement par stratégie commerciale. Mais le fond de sa pensée ne résistera pas à l’incendie du restaurant et à l’inscription xénophobe. Elle renverra son chef étoilé et ira expier en nettoyant l’inscription. Elle engagera Hassan, qui introduira un peu d’épices dans la cuisine française.
L’idée du film est que dans un environnement mondialisé les cuisines doivent s’ouvrir et se mêler, que ce n’est pas la nationalité d’une cuisine qui en fait sa qualité, mais la compétence du cuisinier et son terroir, la qualité de ses produits.
C’est le cuisinier Hassan qui est porteur de toutes ces valeurs : il introduit le vin dans la cuisine indienne et les épices dans la cuisine française et il est amoureux de Marguerite, du terroir. On pourrait presque croire à la sincérité de la démarche, si Hassan ne choisissait de quitter (provisoirement) son terroir pour aller à Paris et revenir avec une troisième étoile, bardé d’un label national à travers la capitale. Un film sympathique, avec de bons acteurs (mention spéciale à Om Puri, qui joue le père de famille), mais il vaut mieux éviter d’en être dupe.
Mélanges cinéma

Rover, de l’australien David Michôd,

Under the skin, réalisé par le britannique Jonathan Glazer.

"On a failli être amies"
comédie d’Anne Le Ny
Après un printemps végétarien au cinéma, l’été fut aux antipodes.
Du côté anglo-saxon, nous avons flirté avec les nourritures interdites dans le film de science-fiction Rover, de l’australien David Michôd, et dans le film fantastique Under the skin, réalisé par le britannique Jonathan Glazer.
Rover décrit un futur proche où toute production économique s’est arrêtée pour cause de faillite financière. La population vit donc sur ses réserves. Elle s’alimente principalement de boîtes de conserves, quand il y en a… Avoir de l’essence et une voiture est plus important, car c’est la condition pour gagner un lieu où l’on trouve encore de quoi vivre. Nous sommes dans une économie davantage du saltus que de l’ager, de la cueillette à défaut d’agriculture. C’est pourquoi le plus simple est de se nourrir de tout ce qui passe à proximité, c’est-à-dire de chiens dans ce coin d’Australie.
Under the skin raconte l’arrivée d’extraterrestres en Ecosse. L’une d’entre elles souhaitera vivre parmi les humains, mais cela s’avérera impossible quant à la sexualité et à l’alimentation. Dans une scène mémorable, l’extraterrestre met trente secondes pour essayer d’introduire un gâteau au chocolat dans sa bouche à cause de son appréhension. Pour finir par le recracher aussitôt. Le choix alimentaire est bien ciblé, car rares sont les personnes qui n’aiment pas le chocolat. Que mangent-ils donc ces extraterrestres ? Le livre dont est adapté le film est sans ambiguïté : ils mangent de la chair humaine. Le film reste en pointillé sur le sujet : on aperçoit l’extraterrestre absorber un humain. Compte tenu du fait que l’extraterrestre est généralement une figure de l’étranger, Under the skin révèle un pessimisme quant à l’intégration de certains étrangers, puisque même ceux qui la souhaitent n’y parviennent pas. L’obstacle à cette assimilation est d’ordre naturel pour l’extraterrestre, puisque sa physiologie est incompatible, mais, au sens figuré, la sexualité et l’alimentation ont une valeur culturelle. La force du genre fantastique est de montrer comment cet obstacle culturel, et donc capable d’évolution, peut devenir naturel et donc insurmontable.
Moins de fatalisme du côté français avec On a failli être amies, la comédie d’Anne Le Ny.
La réalisatrice utilise la cuisine de deux façons : comme substitut sexuel et avec un discours de classe. Le substitut sexuel est très classique : la jouissance gastronomique y fait figure d’orgasme. Le géniteur est un cuisinier, Sam. Sa femme, Carole, se détache de lui, et ceci est signifié par le fait qu’elle n’apprécie plus sa cuisine « trop acide » ou « pas mal ». A l’opposé, Marithé, chargée de formation professionnelle, jouit de tout ce qu’il cuisine. Elle cherchera donc à piquer son mec à Carole. Un schéma très conventionnel, qui offre la possibilité d’éviter les scènes de lit pour montrer la relation sexuelle entre les personnages. En revanche, le point de vue social développe un discours gastronomique plus contemporain. La réalisatrice prend parti pour que la grande cuisine soit accessible au plus grand nombre. Cela se traduit par un changement de femme pour le cuisinier. Carole, la première, est une oisive et passerait ses journées au country club. Elle est l’hôtesse du « Moulin blanc », restaurant étoilé en dehors de la ville et pratiquant des prix astronomiques. On y goûte une cuisine expérimentale. L’autre femme, Marithé, vit dans le quotidien. Elle s’efforce de recaser des ouvrières licenciées d’une usine de jouets. Avec elle, le cuisinier tiendra un restaurant en centre-ville, avec une cuisine plus conventionnelle (ris de veau, tapas) et donc moins onéreuse, mais aussi bonne. Ceci sous-entend qu’il existe une cuisine populaire pas bonne, mais, dans le film, elle reste en filigrane. La réalisatrice nous la montre brièvement : elle n’entend visiblement pas l’attaquer frontalement. Au moment où Marithé va faire une scène à son amour de cuisinier, qui a licencié une femme qu’elle avait fait engager, elle se bourre de marshmallows. C’est une erreur, alimentaire et sur la personne, car Sam n’a pas licencié l’employée (il y a eu une séparation à l’amiable). Le problème avec ce discours social c’est que l’on a du mal à croire qu’une femme qui travaille, qui a été mariée (qui touche probablement une pension alimentaire, car elle a divorcé d’un mari aisé) et dont le fils est suffisamment grand pour avoir une bourse du Massachusetts Institute of Technology, puisse être gênée pour s’offrir un repas au « Moulin blanc » une fois dans l’année. Le point de vue classique de la cuisine se substituant à l’acte sexuel est en revanche bien traité. Du coup, c’est ce point de vue, conventionnel, que l’on retient du film.
Noè

L’homme qui aimait les plantes
Réalisateur : Darren Aronofsky
Billet de Vincent Chenille.
Ce très bon film de Darren Aronofsky nous présente un Noé - ainsi que sa tribu - végétarien. Il semble tout particulièrement apprécier les petites plantes cuites à la braise. Ce régime, dans le film, est très clairement choisi en opposition à celui de Tubal et de sa horde de descendants de Caïn, l’auteur du premier meurtre biblique dans l’histoire de l’humanité. Ceux-ci ont un régime uniquement carné, car la viande « donne de la force ». De la force, mais aussi de la violence et ils sont montrés, comme leur ancêtre, tels des tueurs. Comme dans le dessin animé Le parfum de la carotte, on retrouve cette distinction entre carnivores et végétariens. Cependant, ce n’est pas l’élément distinctif qui les oppose le plus au clan de Noé, car ce dernier aussi donne de bons coups de poings.
Mais il se trouve que les descendants de Caïn ont stérilisé la terre (le paysage est un désert), à force de volonté de puissance, de guerres menées, ce qui a pour résultat que les espèces animales sont en voie d’extinction et la mission de Noé, avec son arche, consistera à les sauver d’un désastre écologique. C’est donc par écologie que le clan de Noé ne mange pas de viande.
Le réalisateur de ce long métrage a expliqué que ce n’était pas avec le texte sur Noé dans la Genèse qu’il pouvait réaliser un film de deux heures, et qu’il lui fallait pour obtenir son film développer le texte. De fait, les dix chapitres consacrés à Noé dans la Genèse ne font que quatre pages. Mais si l’on ne peut critiquer Darren Aronofsky d’avoir voulu développer à partir du texte de la Genèse, on peut lui faire remarquer que, du point de vue alimentaire, son film contredit la Bible : « Et une crainte de vous et une terreur de vous demeureront sur toute créature vivante de la terre et sur toute créature volante des cieux, sur tout ce qui se meut sur le sol et sur tous les poissons de la mer. Ils sont maintenant en votre main. Tout animal qui se meut et qui est vivant pourra vous servir de nourriture. Comme pour la végétation verte, je vous donne tout cela. Seulement la chair avec son âme – son sang – vous ne devrez pas le manger » (Genèse, chapitre 9, versets 2 à 5). Dieu recommande donc à Noé de manger de la viande casher, c’est-à-dire vidée de son sang. C’est une restriction importante, mais moindre que celle de Darren Aronofsky, qui interdit toute viande.
Le réalisateur utilise donc un principe juif pour défendre une philosophie animiste. On comprend bien que le souci du réalisateur est de parler d’aujourd’hui pour faire entendre un message écologiste. Pour être sûr d’atteindre sa cible, il n’hésite pas à faire taire Dieu, dont la voix domine les chapitres de la Genèse pour placer ses propos (comme le « Soyez féconds, croissez et multipliez ») dans la bouche de Noé. Satisfaisant ainsi ceux qui croient et ceux qui ne croient pas en Yahvé, il court aussi le risque de ne satisfaire ni les uns ni les autres. De fait, le film a suscité beaucoup de polémiques, particulièrement Outre-Atlantique. On ne peut pourtant pas reprocher à Darren Aronofsky d’avoir voulu illustrer le message biblique en l’adaptant au cinéma. D’autres l’ont fait avant lui. On ne peut pas non plus reprocher à l’auteur de défendre un message écologiste et animiste, mais, dans ce cas-là, d’autres récits de fiction sont sûrement plus adaptés que la Bible. Subtiliser au message des hébreux une philosophie animiste ce n’est pas servir le message biblique, c’est s’en servir.
A moins de considérer le film comme un plaidoyer envers les Juifs pour les inviter à un régime végétarien qui respecte les préceptes bibliques, mais qui évite les oppositions religieuses ancestrales autour de la viande. Un régime de paix entre les communautés ? Un régime à l’évidence qui accroît les interdits.
Croc, Croc...

Le Parfum de la carotte d’Arnaud Demuynck
Réalisateur : Arnaud Demuynck
Billet de Vincent Chenille.
Sorti le 9 avril 2014, Le Parfum de la carotte est un long métrage destiné à être vu par les plus jeunes ; c’est la raison de sa durée : 45 minutes. Qui plus est, il s’agit d’un assemblage de plusieurs courts métrages, dont le plus long est justement Le Parfum de la carotte. Chaque court métrage a un réalisateur différent, avec des dessins plus ou moins élaborés, cependant le producteur est identique (Arnaud Demuynck) et la carotte est bien l’objet central commun.
Le premier court métrage, La Confiture de carottes, a une démarche pédagogique bien comprise. Il s’agit de donner envie aux tout-petits de manger des légumes, en l’occurrence des carottes, à travers une recette sucrée, et donc susceptible de leur plaire. Ce court métrage est un des rares exemples au cinéma de recette de cuisine présentée dans son intégralité.
La figure humaine est pratiquement absente de ce programme, excepté dans le second court métrage, La Carotte géante, dans lequel un couple avec enfant essaie de déterrer une carotte géante. N’y parvenant pas, ils sont aidés par un chien, un chat et une souris, pour arriver à la sortir. Après cet effort commun, les animaux sont installés à la même table que les humains, sur un pied d’égalité. Dès lors, les animaux, seuls présents dans les courts métrages suivants, peuvent être considérés aussi bien comme des humains que comme des animaux. Et d’ailleurs leur consommation est autant humaine qu’animale. Dans Le Petit Hérisson partageur, qui se déroule en pleine nature, une souris apporte du fromage au pot commun (qui comprend pomme, carotte, noisette, fruits de la cueillette). Et, dans Le Parfum de la carotte, un lapin et un écureuil font la cuisine : carottes en brochette ou bien en gâteau.
Chaque animal / humain est porteur d’une spécialité : le lapin la carotte, l’écureuil la noisette, la souris le fromage et le hérisson la pomme, façon d’illustrer la diversité culturelle des plantes, mais aussi des individus. Cette diversité est montrée comme porteuse de richesses : quand la pomme du hérisson a été mangée par tous les animaux, et que la faim est toujours là, chacun va chercher sa spécialité pour la partager à son tour. Mais lorsqu’il y a intolérance, lorsque l’écureuil en a assez des divers plats aux carottes, il y a séparation des animaux avec la menace de se faire dévorer à son tour par le renard.
Comme il y a assimilation entre animaux et êtres humains, les amateurs de viande animale deviennent identiques à des chasseurs d’humains. C’est l’image du chasseur mâle qui véhicule la méchanceté. Le renard mâle est un chasseur qui veut attraper le lapin et l’écureuil pour les manger, alors que la renarde tente de faire son éducation. Tout juste mange-t-elle des vers de terre (nos futurs plats d’insectes, sans doute) en incitant le mâle à manger du gâteau aux carottes. Cette méchanceté du chasseur est aussi présente dans La Carotte géante. Après l’avoir cueillie ensemble et partagée lors d’un repas, les animaux retrouvent leurs vieilles querelles de chasseurs : le chat veut de nouveau poursuivre la souris, et le chien le chat. Seule la cueillette, qui nécessite toutes les mains, les oblige à être ensemble et à vivre en harmonie.
L’ambition du Parfum de la carotte n’est pas seulement de donner envie aux enfants de manger des carottes, mais d’adopter un régime végétarien, parce que c’est bon, c’est divers, mais aussi parce qu’il permet de régler les divisions culturelles. Ainsi tout le monde est-il rassemblé autour des carottes, choux, aubergines, tomates, pommes et noisettes (il y a juste la lassitude de l’écureuil à manger tout le temps des carottes). L’histoire ne dit pas que le rejet de la viande est une intolérance aux carnivores. La chose est entendue, à l’image du renard, ceux-ci doivent se convertir.
On pourrait prendre Le Parfum de la carotte juste pour un conte pour enfants, si, au même moment, ne sortait sur les écrans un film pour adultes porteur du même discours. Mais cela nous le verrons une prochaine fois…
Only lovers left alive

Les buveurs de sang
Réalisateur : Jim Jarmusch
Billet de Vincent Chenille.
Only lovers left alive n’est pas ce qu’on appelle un film de cuisinier (il n’y en a pas) et son sujet central n’est pas la gastronomie.
Pourtant, à travers cette histoire de vampires, le réalisateur tient un discours gastronomique. Il faut dire qu’il n’y a pas de bestialité dans ce couple de vampires ; au contraire, on y voit tout le raffinement des multiples siècles que l’homme et la femme ont parcourus et, surtout, un esprit contemplatif, dont l’activité principale est tournée vers l’art issu de la période romantique, celle de Byron, de Shelley et de Stoker, qui les a vus émerger.
Ils ne se jettent pas sur leurs proies pour les dévorer, non, ils ne sont pas brutaux. Ils dégustent le sang dans de la jolie vaisselle, appréciant la diversité des provenances. Leur raffinement les pousse à diversifier les produits sanguins et à les consommer, par exemple, en sorbet sous forme d’esquimau… Ils vont aussi faire leur marché, et c’est ce qui évite la violence. Pas de supermarchés du sang, mais des hôpitaux, où, la nuit, ils vont acheter quelques lots à des médecins complaisants. Mais voilà qu’un jour le sang se fait contaminer, l’hémoglobine de qualité se fait rare et l’un des vampires (un ami du couple) décède. Les suceurs de sang commencent à connaître la faim et, pour ne pas périr, ils sont obligés de recourir aux bonnes vieilles méthodes, celles de la barbarie, en plantant leurs canines dans le cou de victimes au corps sain.
Traditionnellement, les films de vampires sont liés à la sexualité. Dans les années 1950-1960, Christopher Lee traduit l’érotisme sous les traits du comte Dracula, alors que le film de Francis Ford Coppola, en 1992, parle du sang à l’époque du Sida.
Ce n’est pas le cas avec Only lovers left alive, bien qu’il parle de contamination du sang, car l’action se situe bien en 2013 : le personnage principal cite Youtube. Or, si le Sida constituait une nouveauté en 1992, l’épidémie n’est pas apparue en 2013.
Paradoxalement, Jim Jarmusch traite du sang comme d’un produit culturel (pourtant quoi de plus naturel que le sang ?) et c’est ce qui établit le lien entre cette histoire de vampire et la gastronomie. On peut, sans trahir, établir un parallèle entre les lots sanguins achetés à l’hôpital dans leur emballage métallique et les barquettes de l’industrie alimentaire achetées chez un traiteur ou au supermarché. Pourtant le propos du film ne vise pas uniquement l’industrie alimentaire comme bien culturel. L’allusion à Youtube n’est pas innocente. Le vampire principal de l’histoire est un compositeur qui entend pratiquer l’art pour l’art et se méfie de la célébrité et des produits commerciaux. En cela le vampire se distingue du zombie, consommateur de la musique que l’on trouve sur Youtube. Or le zombie, créé sous la plume de Richard Matheson, naît d’une épidémie, d’une contamination. Le film parle d’une épidémie culturelle, à laquelle l’auteur de musique (et le réalisateur du film) résiste. Les produits de l’industrie alimentaire sont désignés comme ceux de l’industrie musicale et audiovisuelle. Le plus intéressant est de noter que deux films américains récents mettent en cause l’industrie agro-alimentaire : L’île des Miam-nimaux parlant d’Apple et Only lovers left alive, de Youtube, deux films qui, pourtant, dans le paysage cinématographique, n’ont pas grand-chose en commun. Le Jim Jarmusch est un film d’auteur destiné à des adultes, alors que L’île des Miam-nimaux est un dessin animé destiné avant tout aux enfants et produit par une multinationale.
L’île des miam-nimaux
Tempête de boulettes géantes 2
Film d’animation de Cody Cameron et Kris Pearn
Billet de Vincent Chenille.
Le film est la suite de Tempête de boulettes géantes, réalisé en 2009 par Phil Lord et Chris Miller. Mais pour les amateurs du premier épisode, cette fois-ci, il n’y a ni tempête ni pluie de boulettes géantes ; pas de surenchère spectaculaire donc de ce côté-là. Cependant, il s’agit bien d’une suite, car on y retrouve les personnages principaux, l’inventeur Flint Lockwood et la météorologue Sam Sparks, après la chute des aliments géants.
Depuis ce début se sont développées, à partir des aliments géants, de nouvelles espèces comme le calamar babouin, les pommes de terre hippopotame, les bananes volailles. Mais le film n’est pas une alarme contre les manipulations génétiques, même si certains personnages de l’histoire se montrent prompts à vouloir les exterminer. Sam Sparks montre que cette nouveauté crée une grande diversité, et donc une grande richesse. De ce point de vue, l’anthropomorphisme des végétaux et des animaux présente la faculté de concilier les végétariens et les carnassiers dans un vaste domaine des espèces vivantes ; et donc d’habituer les enfants, qui sont le public privilégié pour ce dessin animé, à accepter aussi bien la viande que les légumes (même si les personnages principaux privilégient les gâteaux, le café et le chocolat !).
Mais voilà ! Le Pr Chester V veut exterminer ces nouvelles espèces. Il ne s’agit pourtant pas d’un plaidoyer écologique en faveur de la protection des espèces. Car dans les espèces menacées par Chester, il y a le cheeseburger araignée. La protection souhaitée n’est donc pas seulement naturelle, mais culturelle. Chester V, à l’aide de ses grands aspirateurs, veut récupérer ces nouvelles espèces pour les broyer et les intégrer à sa nouvelle barre alimentaire 8.0. Et c’est là que le bât blesse, car le propos semble remettre en cause l’industrie agro-alimentaire dans son ensemble. Et si l’on suit la logique de ce propos, il ne faut pas toucher à ces espèces, et par conséquent ne rien manger : absurde.
Or le propos n’est pas celui-là. Le sujet se révèle en une fraction de seconde, lorsque Chester veut se débarrasser de Flint Lockwood, de Sam Sparks et de tous leurs amis dans la broyeuse pour confectionner la barre alimentaire 8.0. Et s’il veut s’approprier ces nouvelles espèces, c’est parce qu’elles ont un goût bon et nouveau. C’est la définition même de l’utilisation d’arômes dans l’industrie alimentaire. Un bon goût qui peut cacher de l’aliment d’origine humaine (l’idée se trouve confortée par l’anthropomorphisme des espèces). Ce sont les filières alimentaires pour les produits élaborés de l’industrie agro-alimentaire qui sont donc en question. Une idée tout à fait défendable, et qui peut trouver un large écho chez nous, après l’affaire du bœuf Spanghero. Et, de fait, cette crise a eu pour effet de détourner le public de l’industrie alimentaire, des plats cuisinés, de tout ce qui peut paraître obscur à force d’avoir été broyé.
Mais cette idée est bien mal défendue, tant le propos dans le film entretient la confusion. Le débat est subtil et il ne peut se résumer en des formulations manichéennes du type protection des espèces et extermination, ni nature contre industrie. C’est un débat que des enfants peuvent comprendre pourtant. Mais une présentation manichéenne a toutes les chances d’obscurcir ce débat. Or le mode de narration du film est dans une présentation manichéenne, car sa forme est inspirée de l’heroic fantasy, très en vogue, avec du côté des gentils Flint Lockwood et ses amis, et de l’autre, le méchant Chester V, inventeur de la barre alimentaire 8.0 et clone des dirigeants d’Apple, firme concurrente de Sony. Sony étant producteur de Tempête de boulettes géantes…
Les saveurs du Palais, un film de Christian Vincent
Une invitation à l'Elysée, par Vincent Chenille *
Sorti sur les écrans en septembre 2012, puis en DVD blu-ray en janvier 2013, « Les saveurs du palais » est un film de Christian Vincent avec Catherine Frot et Jean d’Ormesson, basé sur l’ouvrage de Danièle Mazet-Delpeuch, qui fut la cuisinière personnelle du Président François Mitterrand, « Carnets de cuisine : du Périgord à l’Elysée ». Ce film nous montre des situations bien réelles, car fondées sur une expérience documentée, que l’on trouve peu fréquemment dans les films de cuisiniers. Pas le fait qu’il s’agisse d’une femme qui dirige les cuisines, car entre la Babette du « Festin de Babette », la Martha de « Chère Martha », la Julia de « Julie et Julia » les femmes chefs cuisiniers à l’écran sont plus nombreuses que dans la réalité. « Les saveurs du palais » par la confrontation qu’il présente entre le chef cuisinier officiel et la cuisinière imposée par François Mitterrand, montre justement la difficulté pour les femmes à se faire admettre à cette place. Il montre aussi comment un chef est un chercheur de saveurs et ne réussit pas un nouveau plat, par les associations d’aliments, du premier coup. Mais la grande force du film réside dans le fait qu’il a su évacuer le contexte historique de la présidence. Aucun nom politique réel n’est cité, aucune date précise n’est évoquée, aucune période électorale n’est avancée. Nous savons qu’il s’agit de Mitterrand, parce que le dossier de presse le dit mais, de fait, il pourrait s’agir d’un autre président situé dans la période actuelle. Une période actuelle, où les savoir-faire patrimoniaux et les productions locales sont menacés. L’héroïne, Hortense Laborit, les défend en puisant dans les livres de recettes des siècles passés et en faisant appel à ses amis du Périgord.
* Vincent Chenille: En poste au département de l'Audiovisuel à la Bibliothèque nationale de France, après une thèse d'histoire sur la mode, sous la direction de Jean-Louis Flandrin. Il a travaillé sur les représentations politiques au cinéma avec Marc Gauchée, et dans les séries télévisées, au sein du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (où il est chercheur associé). Il a publié "Le plaisir gastronomique au cinéma" en 2004, "Bon appétit Mr Bond" en 2008, ainsi que "La faim au cinéma" dans Anthropology of food.

Les Bibliothèques gourmandes sont soutenues par la Ville de Dijon.


